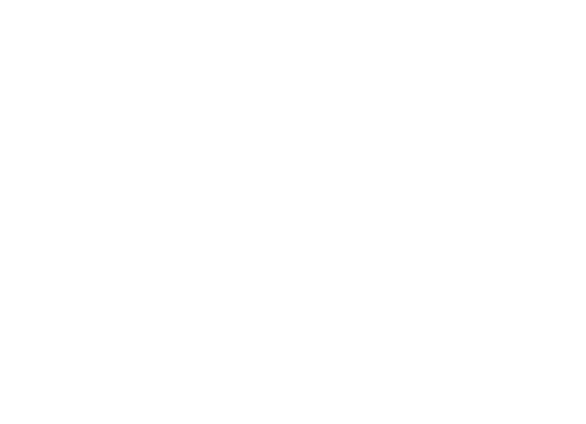« Obliger un ingrat, c’est perdre le bienfait », nous dit le proverbe. Cette mise en garde, pleine de bon sens, est loin d’attirer les faveurs du législateur français. Que ce soit en matière contractuelle ou procédurale, le droit hexagonal consacre bien la force obligatoire de tout contrat, qui se traduit également par un droit à l’exécution, dont peut se prévaloir tout justiciable. D’ailleurs, le nouvel article 1217 du code civil envisage l’exécution forcée du contrat comme un des cinq remèdes à l’attitude (ingrate) du cocontractant, ne daignant pas satisfaire aux obligations qu’il s’était pourtant juré d’accomplir. Les pouvoirs de ce remède sont d’ailleurs énumérés comme suit par l’article 1221 :
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
La loi forcerait donc l’ingrat à exécuter sa prestation, sans toutefois que son bénéficiaire n’en perde les bienfaits. Contrairement à ce qu’affirme notre proverbe suranné, le législateur ne laisse pas à l’abandon les intérêts du créancier. Pour certains, cette attitude traduirait un « mouvement général » en sa faveur[1] comme pour rétablir un certain équilibre ou une certaine justice contractuels. Quoi qu’il en soit, l’exécution forcée du contrat reste une notion aux contours très singuliers. L’article 1221 reste à la fois indifférent à la gravité de l’inexécution et pose une condition de mise en demeure préalable avant toute exécution forcée du contrat (I). Cependant, il n’admet pas ce mécanisme en cas d’impossibilité d’exécution ou de disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier (II).
I. La mise en œuvre générale de l’exécution forcée.
« Obliger un ingrat, c’est obtenir les bienfaits ». Cette version détournée du proverbe résume parfaitement la position du législateur dans cet article 1221 (Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature). Se jouant du bon sens proverbial, le législateur renforce, de toute évidence, les droits du créancier. Contradiction ou non : l’inexécution, dans son sens le plus large, donne droit à exécution (A). Ce droit à exécution doit tout de même se conjuguer avec les autres grands principes du droit contractuel, ce qui se traduit notamment par la nécessité d’une mise en demeure préalable (B).
A. Obligation et inexécution générales.
L’article 1221 identifie le bénéficiaire du droit à l’exécution forcée du contrat comme le « créancier d’une obligation ». Loin d’être anodine, l’utilisation de cet article indéfini reste cruciale. Elle traduit la mise en œuvre de l’exécution forcée dès lors qu’une inexécution est constatée[2]. On comprend là qu’aucune exigence spécifique n’est posée concernant la nature de l’obligation. Pas de discrimination donc entre obligation de faire, de ne pas faire et de donner, qui avait si longtemps occupé les prétoires des juges de la Cour de cassation[3].
Encore une fois, le texte de l’article 1221 s’inscrit parfaitement dans la logique de la réforme du droit des obligations[4]. Visant à simplifier certains aspects du droit français, la réforme éradique les distinctions jadis employées par la jurisprudence. Sont tout autant concernées la non-délivrance d’une chose vendue que l’exécution d’une prestation de service ou encore l’interdiction de commercialiser certains produits (cf. 1ère civ, 16 janvier 2007, n°06-13.983). Ainsi, le créancier peut tout simplement obtenir ce à quoi il s’attendait ou, plus précisément, ce à quoi il avait droit contractuellement parlant.
D’ailleurs, une dernière précision sémantique s’impose. En réalité, si législateur vise « une obligation », il faut entendre par cette expression un champ d’application vaste, voire élastique. L’article 1221 concerne, en fait, toutes les obligations et donc « l’obligation » en général.
En plus de l’indifférence prononcée à l’égard de la nature de l’obligation, l’article 1221 manifeste aussi son absence de considération quant à la gravité de l’inexécution. Contrairement aux autres remèdes de l’article 1217, l’article 1221 n’impose pas de démontrer un degré de gravité quelconque. L’article 1220 introduit, par exemple, la faculté de se prémunir d’une exception d’inexécution par anticipation mais cette inexécution à venir doit être d’un degré tel qu’elle en devient manifeste. L’anticipation n’est en fait qu’illusoire car l’inexécution à venir sera inexorable. Or, rien de tel n’est prévu pour l’exécution forcée du contrat. En plus de toute obligation, le législateur vise aussi toute inexécution.
Il confirme là la théorie prétorienne de l’arrêt Le Coyote, par lequel les juges du fond n’étaient pas tenus, aux yeux de la Cour de cassation, d’examiner un degré d’inexécution de la prestation contractuelle[5]. Obliger un ingrat, c’est donc l’obliger de quelle que manière que ce soit à restituer les bienfaits du contrat au créancier.
B. La nécessité d’une mise en demeure.
On l’a vu, l’article 1221 laisse le champ libre à la sanction de toute inexécution. Cette liberté générale trouve cependant un tempérament au sein même du texte. Toute action du créancier est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur d’exécuter ses prestations.
Sans doute, la réforme a-t-elle tenu à ne pas dissocier force obligatoire du contrat et obligation de loyauté des parties. L’esprit même du contrat doit nécessairement tenir compte de ces deux grands principes. A la lecture du texte, on comprend que la loyauté du créancier doit se traduire par l’obligation de laisser une dernière chance au débiteur d’accomplir son devoir, sans en subir les conséquences néfastes.
La mise en demeure permet de prolonger, un tant soit peu, le contrat et de réaffirmer une seconde fois le consentement réciproque des parties. En l’absence de réponse du débiteur, l’action en exécution forcée représente alors l’ultime étape du processus contractuel, celle qui rapproche un peu plus les parties du gouffre extracontractuel. Après tout, le débiteur, qui ne veut plus exécuter sa prestation, a rétracté son consentement même s’il l’a fait à la dernière minute, c’est-à-dire beaucoup trop tardivement. C’est pourquoi la mise en demeure préalable s’analyse nécessairement en garde-fou du contrat stricto sensu.
Mais c’est un garde-fou que l’on peut aisément écarter. En effet, un parallèle entre l’article 1221 et 1334 du code civil nous révèle que la mise en demeure est susceptible de prendre soit la forme d’une sommation, soit celle d’un acte portant interpellation suffisante, soit enfin résulter de la seule exigibilité de l’obligation (cf. article 1344 du code civil). Aucune exigence de forme n’est en réalité posée, concernant la forme de cette mise en demeure. En pratique, il pourrait tout aussi bien s’agir d’une lettre simple que d’un LRAR. Une certaine souplesse est ainsi admise, encore une fois, en faveur du créancier. A tel point qu’il serait même envisageable que la mise en demeure soit écartée directement par une clause contractuelle.
Ainsi, le législateur a-t-il facilité la mise en œuvre de l’exécution forcée par la généralité des obligations, inexécutions visées ainsi que de la souplesse formelle de la mise en demeure. Toutefois, ce cas général de mise en œuvre de l’exécution forcée du contrat trouve des limites bien particulières qu’il convient d’analyser.
II. Les prohibitions particulières de l’exécution forcée.
Les prohibitions particulières de l’exécution forcée viennent compléter le tableau de la mise en œuvre générale de l’exécution forcée (sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier). Cette fois-ci, le législateur affirme de vive voix qu’ « obliger le reconnaissant, c’est perdre les bienfaits ». Plus précisément, l’exécution forcée trouve ses limites à la fois à travers la survenance d’une impossibilité d’exécution (A) et la disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier (B).
A. La ou les impossibilité(s) d’exécuter le contrat.
L’impossibilité d’exécuter le contrat constitue la première limite à l’exécution forcée du contrat. Cette notion, telle que la conçoit le nouveau code, n’est pas sans susciter quelques réflexions autour de sa signification. Doit-elle s’apparenter à la force majeure ou constitue-t-elle une impossibilité, bien à part d’exécution du contrat ?
Pour dessiner les contours de la notion, il est essentiel de se pencher sur des dispositions voisines, celles de l’article 1128. Cet article reprend la théorie prétorienne de la force majeure, tout en en précisant les contours. Constitue un cas de force majeure, écartant toute exécution forcée du contrat, un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.
De nombreuses querelles jurisprudentielles ont maintes fois remis en question cette définition, donnant lieu à un certain sentiment d’insécurité juridique, parfois qualifié de « loterie judiciaire »[6]. Certaines chambres privilégiaient jadis la notion d’irrésistibilité, tandis que d’autres refusaient de dissocier les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Néanmoins, un arrêt du 14 août 2006, rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, a souligné toute l’importance de la conjugaison des critères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité, sans toutefois se prononcer sur la notion d’extériorité. Comme le souligne Geneviève Viney, l’imprévisibilité demeure un critère tout aussi essentiel à la reconnaissance d’une force majeure, que celui d’irrésistibilité[7]. L’outil contractuel n’est-il pas, après tout, un acte de prévision ? Ce qui n’est pas prévu, sortirait alors de la sphère contractuelle[8] ; et « il paraît tout naturel de s’y référer pour définir les limites de l’engagement du débiteur »[9].
Cependant, la notion de force majeure n’est pas l’unique acception de l’expression d’exécution impossible, envisagée par l’article 1221 du code civil. L’impossibilité d’exécuter pout tout aussi bien résulter d’une impossibilité matérielle dans le cas d’un bien détruit, irremplaçable. Elle peut aussi résulter d’une impossibilité juridique, notamment en cas de cession d’un bien, qui ne pourra pas être revendiqué entre les mains d’un tiers. Enfin, la doctrine envisage également que cette impossibilité résulte aussi d’une atteinte trop importante aux libertés et droits fondamentaux du débiteur. L’avant-projet Catala qualifiait cette dernière catégorie d’impossibilité de « coercition attentatoire à la liberté ou à la dignité du débiteur »[10]. Cette impossibilité, presque morale, est particulièrement intéressante en ce qu’elle impose le respect d’une liberté fondamentale, qui contrevient pourtant à une liberté antérieure de contracter. En réalité, elle résout un conflit potentiel entre différents types de libertés et instaure une hiérarchie entre elles. Le droit français privilégie ainsi les libertés dites fondamentales au détriment des libertés dites contractuelles.
Ainsi, l’impossibilité d’exécution peut-elle avoir plusieurs acceptions possibles. Elle demeure donc une notion polysémique dont la richesse manque cependant de précisions. On regrette là l’absence de rigueur rédactionnelle de la part du législateur.
B. La disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier.
La disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier constitue la seconde limite au mécanisme d’exécution forcée du contrat. Cette seconde limite est une véritable nouveauté. La seule mention du « coût » représente manifestement « une percée de la prise en compte des données économiques en droit commun du contrat »[11]. Sa portée divise toutefois la doctrine. Thomas Génicon, par exemple, y voit un changement radical mais regrettable car constituant un véritable « affaissement des droits du créancier contractuel bafoué »[12]. D’autres, tels Daniel Mainguy, n’observent qu’une légère modification par rapport au droit antérieur[13].
Quoi qu’il en soit, la prise en compte du coût de la prestation du débiteur par rapport à l’intérêt du créancier constitue un véritable changement de principe. Le législateur s’écarte ici de la jurisprudence antérieure. A titre d’exemple, la troisième chambre civile avait prononcé, dans un arrêt du 11 mai 2005, la démolition d’un immeuble, réalisé par un constructeur ayant commis une erreur de métrage de 33 cm. Cette démolition avait été demandée par le propriétaire, qui souhaitait voir son bien entièrement reconstruit de manière à respecter les dispositions du contrat. Désormais, tel ne sera plus le cas. Le coût manifestement disproportionné entre la démolition puis la reconstruction d’un immeuble et l’intérêt du créancier devront être mis en balance. Restreint, le rôle du juge consistera essentiellement à diriger le curseur vers la notion soit de proportionnalité, soit de disproportion manifeste entre prestation du débiteur et intérêt du créancier.
A noter que cette nouvelle exigence, posée à l’article 1221, semble avoir influencé d’autres branches du droit civil, tel le droit de la propriété. Très récemment, la troisième chambre civile a admis l’empiètement de propriété dans la sphère extra-contractuelle[14], ce qui n’est d’ailleurs pas sans lien de connexité avec l’article 1221. L’empiètement de propriété, dû à une mauvaise construction d’immeuble, ne pourra plus entraîner la démolition du bien dès lors que son coût est manifestement disproportionné par rapport à l’intérêt qu’en tire le propriétaire.
Reste à savoir ce que le législateur entend par l’expression « disproportion manifeste ». A première vue, « disproportion manifeste » ne signifie pas « disproportion » tout court. Le curseur du juge ne doit donc pas s’arrêter sur la simple disproportion, qui traduit une différence excessive entre deux ou plusieurs choses[15]. Il doit, au contraire, tenir compte d’une disproportion évidente ou flagrante. La précision du vocable en limite nécessairement la portée. Autrement dit, la limite (de la disproportion entre coût et intérêt) n’est pas sans limite. Très intéressante, cette notion n’est pas sans rappeler le déséquilibre manifestement excessif des clauses abusives de l’article 1171. Le législateur pousse donc jusqu’au bout son analyse économique du contrat, exposée dans le code civil.
De manière incidente, on peut aussi noter que la disproportion manifeste, visant à permettre un peu plus l’exécution forcée du contrat, reste l’exact inverse de l’efficient breach of contract[16], si chère aux pays de common law. Cette théorie repose tout autant sur une analyse économique des relations contractuelles mais préfère prononcer la rupture efficace du contrat, permettant au débiteur de contracter plus avantageusement avec un tiers et au créancier d’obtenir des dommages-intérêts. Autrement dit, pour le droit anglophone, « obliger un ingrat, c’est perdre les bienfaits ». Droit anglophone et proverbe français sont du même avis. Néanmoins, certains auteurs décrivent l’efficient breach of contrat comme une vision tronquée des relations contractuelles, en ce qu’elle se place uniquement du côté du débiteur sans préoccuper de la place du créancier. Au contraire, le droit français, et plus particulièrement l’article 1221, ont un œil bienveillant à l’égard du créancier, victime d’une inexécution contractuelle. Pour eux, obliger l’ingrat, c’est bien obtenir les bienfaits du contrat.
[1] Gaël Chantepie et Mathias Latina, La réforme du droit des obligations : commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, Dalloz, 2016, p. 548.
[2] Idem.
[3] Voir notamment 1ère civ, 16 janvier 2007, n° 06-13.983.
[4] Ibidem.
[5] 3ème civ, 22 mai 2013, n°12-16.217.
[6] Geneviève Viney, « La force majeure : une définition spécifique à la matière contractuelle ? », RDC, 2006, p. 1207.
[7] Idem.
[8] Ibidem.
[9] Voir supra.
[10] Avant-projet Catala, article 1154, alinéa 3.
[11] Gaël Chantepie et Mathias Latina, La réforme du droit des obligations : commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, Dalloz, 2016, p. 548.
[12] Thomas Génicon, « Contre l’introduction du « coût manifestement déraisonnable » à la reconnaissance d’un « droit d’option », Droit et patrimoine, 2014, n° 240, p. 60.
[13] Daniel Mainguy, « Du « coût manifestement déraisonnable » à la reconnaissance d’un « droit d’option », Droit et patrimoine, 2014, n° 240, p. 60.
[14] 3ème civ, 10 novembre 2016, n°15-25.113.
[15] Le Petit Robert, voir « disproportion ».
[16] Ou violation efficace du contrat.