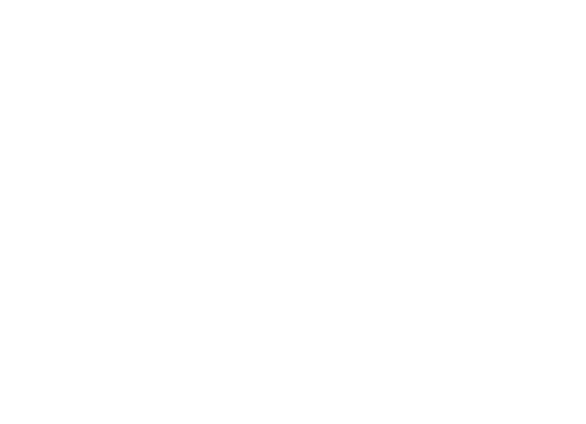Commentaire de Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.078
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 septembre 2025 mérite une attention toute particulière, tant par la portée du principe qu’il consacre que par les interrogations qu’il suscite quant à son champ d’application et ses fondements théoriques. En cassant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 23 janvier 2024, la Cour de cassation pose une règle d’une rigueur remarquable en matière de concurrence déloyale fondée sur l’appropriation d’informations confidentielles par un ancien mandataire social ou un ancien salarié.
L’affaire trouve son origine dans les relations qu’entretenaient le vice-président de l’association Super VW Festival et cette association organisant un festival automobile dédié aux véhicules de marque Volkswagen. Le vice-président avait exercé ses fonctions jusqu’à la fin de l’année 2016. Le 24 août 2016, il avait communiqué à son futur associé la balance des comptes de l’association pour l’année 2016. Par la suite, ces deux personnes avaient créé la société Motorfest qui organisa un festival concurrent en juillet 2017 et 2018. L’association Super VW Festival assigna en réparation pour concurrence déloyale, action que la cour d’appel de Rennes rejeta au motif que le document transmis était succinct et ne comportait pas d’information stratégique.
C’est précisément sur ce point que la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en affirmant dans une formulation d’une netteté remarquable que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues pendant l’exécution du contrat de travail ou du mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.
Cette décision appelle une double lecture, d’une part quant à la conception objective de la faute qu’elle consacre en s’inspirant de la loi de 2018 sur le secret des affaires, d’autre part quant aux extensions et limites de ce principe rigoureux.
I. La sanction de la divulgation d’informations confidentielles à une société concurrente
La solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 septembre 2025 se distingue par sa rigueur et son caractère objectif. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui, depuis 2022, assimile la simple détention d’informations confidentielles à une faute autonome de concurrence déloyale, tout en puisant son inspiration dans les principes consacrés par la loi du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires.
A. De l’apparence de la détention à la réalité de la divulgation
La cour d’appel de Rennes avait fondé sa décision de rejet sur une double considération, estimant d’une part que la transmission du document financier ne constituait pas en soi un acte de concurrence déloyale, et d’autre part que le document était succinct et ne comportait pas d’information stratégique. Cette analyse, qui repose sur une appréciation qualitative du contenu de l’information divulguée, reflète une approche traditionnelle de la concurrence déloyale qui exige la démonstration d’un préjudice effectif et d’une faute caractérisée par son impact concret sur l’activité du concurrent.
Or, c’est précisément cette démarche que la Cour de cassation censure en considérant comme inopérant le motif tiré du caractère succinct de l’information et de l’absence d’information stratégique. La Haute juridiction adopte ainsi une approche radicalement objective de la faute en matière de concurrence déloyale fondée sur l’appropriation d’informations confidentielles. Le caractère confidentiel de l’information suffit à caractériser la faute, indépendamment de toute appréciation de sa valeur stratégique ou de son impact concurrentiel. Cette solution marque une évolution significative de la jurisprudence, puisqu’elle fait de la simple détention d’informations confidentielles par un concurrent un fait générateur de responsabilité civile délictuelle.
Il convient toutefois de souligner que la solution retenue par l’arrêt du 24 septembre 2025 n’est pas véritablement novatrice. Elle s’inscrit dans un courant jurisprudentiel déjà fermement établi depuis l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 décembre 2022 (Com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860). Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé que le transfert par d’anciens salariés d’informations confidentielles n’était pas fautif en l’absence de preuve de l’exploitation de ces informations par un moyen fautif. La Cour de cassation avait cassé cet arrêt en affirmant déjà que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.
L’arrêt de 2025 confirme donc un courant jurisprudentiel particulièrement rigoureux qui fait de la détention une faute autonome. Cette conception objective de la faute présente plusieurs avantages. Elle simplifie d’abord considérablement la charge de la preuve pesant sur le demandeur, qui n’a plus à démontrer que l’information divulguée présentait un caractère stratégique ou qu’elle a effectivement servi à l’activité concurrente. Il suffit d’établir que l’information était confidentielle et qu’elle a été obtenue durant l’exécution du mandat ou du contrat de travail. Cette approche présente également l’avantage de la sécurité juridique en traçant une ligne claire entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Un ancien mandataire social ou un ancien salarié sait désormais qu’il ne peut détenir aucune information confidentielle de son ancien employeur ou mandant, quand bien même cette information lui paraîtrait anodine ou dépourvue d’intérêt stratégique.
B. Une jurisprudence inspirée par la loi du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires
L’analyse la plus stimulante de cet arrêt réside dans la mise en évidence d’une interprétation du droit de la responsabilité civile qui s’inspire manifestement des principes issus de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Cette loi, qui a transposé la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit dans le Code de commerce un régime spécifique de protection des secrets des affaires aux articles L. 151-1 et suivants. Or, les faits de l’espèce sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi, puisque la communication de la balance des comptes a eu lieu le 24 août 2016.
Cependant, la lecture de l’arrêt du 24 septembre 2025 au regard de l’article L. 151-4 du Code de commerce s’avère particulièrement éclairante. Cet article dispose que l’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte notamment de tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. Cette disposition consacre une clause générale de déloyauté qui vient compléter les hypothèses expressément visées par le texte.
La formulation retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté présente des similitudes frappantes avec cette logique. En affirmant que le seul fait de détenir des informations confidentielles obtenues durant l’exécution du mandat constitue un acte de concurrence déloyale, la Cour raisonne comme si elle appliquait l’esprit de l’article L. 151-4 du Code de commerce. Les circonstances de l’espèce caractérisaient manifestement un comportement déloyal et contraire aux usages en matière commerciale. La situation fiduciaire du vice-président de l’association en constituait l’archétype.
Cette convergence révèle que la Cour de cassation, tout en se fondant formellement sur l’article 1240 du Code civil qui régit la responsabilité civile délictuelle de droit commun, s’inspire en réalité des principes qui ont été codifiés par la loi de 2018. Cette démarche peut surprendre au premier abord, puisque la loi du 30 juillet 2018 n’était pas applicable aux faits de l’espèce. Toutefois, elle s’explique parfaitement si l’on considère que cette loi n’a fait que codifier et systématiser des principes qui préexistaient dans la jurisprudence française relative au savoir-faire et aux informations confidentielles.
L’inspiration puisée dans la loi de 2018 trouve une illustration particulièrement nette dans la manière dont la jurisprudence traite de la détention d’informations confidentielles. La loi de 2018 distingue en effet l’obtention illicite du secret des affaires, visée à l’article L. 151-4 du Code de commerce, et l’utilisation ou la divulgation illicites, visées aux articles L. 151-5 et L. 151-6 du même code. Mais cette distinction ne signifie pas que l’obtention ne soit sanctionnée qu’en cas d’utilisation ultérieure. Au contraire, l’article L. 151-4 sanctionne l’obtention illicite en tant que telle, indépendamment de toute utilisation ou divulgation. De même, les articles L. 151-5 et L. 151-6 sanctionnent l’utilisation et la divulgation comme des fautes autonomes. La loi de 2018 consacre donc une triple faute possible, l’obtention, l’utilisation et la divulgation constituant trois comportements distincts mais également répréhensibles.
La jurisprudence, en visant la détention des informations confidentielles, assimile précisément cette détention à l’obtention illicite au sens de la loi de 2018. Cette lecture permet de comprendre l’approche de la Cour de cassation, qui sanctionne le fait même d’avoir conservé des informations confidentielles après avoir quitté ses fonctions pour participer à une activité concurrente, sans qu’il soit nécessaire de démontrer leur utilisation effective. Comme dans la loi de 2018, l’obtention ou la détention constitue une faute autonome qui n’a pas besoin d’être complétée par une utilisation pour engager la responsabilité de son auteur.
Dans le cas d’espèce, la balance des comptes de l’association Super VW Festival pour l’année 2016 constituait manifestement une information confidentielle. Elle n’était pas généralement connue ou aisément accessible, puisqu’il s’agissait d’un document comptable interne. Elle revêtait une valeur commerciale, même si la cour d’appel avait tenté de minimiser cette valeur en la qualifiant de succincte et dépourvue d’information stratégique. Enfin, elle faisait l’objet de mesures de protection, puisqu’elle n’était accessible qu’aux dirigeants de l’association.
En considérant que la simple détention de cette information par le vice-président, après qu’il eut quitté ses fonctions et participé à la création d’une société concurrente, constituait un acte de concurrence déloyale, la Cour de cassation applique exactement le même raisonnement que celui qui sous-tend l’article L. 151-4 du Code de commerce en matière de caractérisation de la faute. La situation fiduciaire du vice-président caractérisait un comportement déloyal et contraire aux usages en matière commerciale au sens de cet article. Un vice-président d’association qui communique les données comptables confidentielles de l’association à une personne qui va devenir son associé dans une entreprise concurrente se rend coupable d’un manquement manifeste à son obligation de loyauté.
II. La portée de la décision
Au-delà de la portée immédiate de sa solution, l’arrêt du 24 septembre 2025 présente un double intérêt. D’une part, il étend l’application du principe à des situations nouvelles par un obiter dictum significatif et par son application aux dirigeants d’associations. D’autre part, il soulève d’importantes questions quant aux limites de ce principe rigoureux et aux modalités pratiques de sa mise en œuvre.
A. Les difficultés pratiques : de la preuve de la divulgation implicite aux modalités de réparation
Si la Cour de cassation s’inspire manifestement de la loi de 2018 pour caractériser la faute de manière objective, cette approche rigoureuse soulève de sérieuses interrogations qui touchent à la fois à la légitimité de cette conception extensive de la faute et aux modalités pratiques de mise en œuvre du principe ainsi consacré.
L’assimilation apparente de la détention à une faute autonome mérite d’être critiquée car, traditionnellement en droit de la concurrence déloyale, ce n’est pas la détention d’une information confidentielle qui est prohibée, mais son usage ou sa divulgation. L’article 1112-2 du Code civil, applicable aux négociations précontractuelles, en fournit une illustration claire en disposant que celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité. Le texte prohibe donc l’usage ou la divulgation, non la simple détention. De manière encore plus significative, l’article L.1227-1 du Code du travail dispose que le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de trente mille euros. On constate ainsi qu’en droit pénal du travail, c’est la révélation, forme d’utilisation du secret, qui est au cœur de la sanction pénale, et non l’obtention ou la détention en tant que telles.
Or, la détention d’informations confidentielles résulte parfois, et même le plus souvent, des fonctions occupées par le défendeur. Elle n’a en elle-même rien d’illicite. C’est en principe son usage qui peut l’être. Toutefois, une lecture plus attentive de la formulation retenue par la Cour de cassation dans les arrêts de 2022 et 2025 révèle que ce qui est véritablement sanctionné n’est peut-être pas exactement ce que la terminologie employée pourrait laisser penser. En effet, les deux arrêts sanctionnent le fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié ou l’ancien mandataire social d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié ou ce mandataire social pendant l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat.
Cette formulation met en lumière deux moments distincts : d’une part, l’obtention des informations par la personne physique pendant l’exécution de son contrat ou de son mandat, d’autre part, la détention de ces mêmes informations par la personne morale nouvellement créée. Or, entre cette obtention par la personne physique et cette détention par la personne morale, il y a nécessairement un acte intermédiaire que la Cour de cassation ne mentionne pas expressément mais qui est logiquement impliqué : la transmission des informations de la première vers la seconde. C’est précisément cette transmission qui constitue le comportement fautif, puisqu’elle suppose que l’ancien salarié ou l’ancien mandataire a communiqué, révélé, divulgué les informations confidentielles obtenues dans le cadre de ses anciennes fonctions à la société concurrente qu’il a contribué à créer.
Or, cette transmission n’est qu’une forme particulière de divulgation au sens de la loi du 30 juillet 2018. L’article L.151-5 du Code de commerce dispose en effet que l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret des affaires de manière illicite ou qui, au moment de l’utilisation ou de la divulgation, savait ou aurait dû savoir, au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de manière illicite. L’article L.151-6 complète ce dispositif en visant notamment la personne qui a obtenu le secret des affaires et qui, au moment de l’obtention, savait ou aurait dû savoir, au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de manière illicite.
La décision commentée sanctionne donc, sous l’apparence d’une sanction de la simple détention, la divulgation opérée par l’ancienne partie prenante de l’entreprise concurrente vers la société nouvellement créée. Cette divulgation répond parfaitement aux conditions posées par l’article L.151-5 du Code de commerce. Elle est réalisée sans le consentement du détenteur légitime, c’est-à-dire de la société ou de l’association concurrente victime. Elle est le fait d’une personne qui a obtenu le secret en adoptant un comportement déloyal, puisque l’ancien salarié ou l’ancien mandataire a emporté avec lui une information sensible obtenue pendant l’exécution de son contrat ou de son mandat, information qu’il n’était pas censé conserver après la cessation de ses fonctions. La société bénéficiaire de cette divulgation, de son côté, savait nécessairement, au moment de la réception de ces informations, qu’elles avaient été obtenues de manière déloyale, puisqu’elle avait été créée avec la participation de cette même personne.
En l’espèce, ce qui a permis à la Cour de cassation de caractériser une faute n’est donc pas tant le fait que l’ancien vice-président ait participé à la création d’une société concurrente en soi, mais le fait qu’il ait communiqué le 24 août 2016 la balance des comptes de l’association à son futur associé. Cette communication constitue précisément la divulgation sanctionnée. La création de la société concurrente postérieurement à cette communication ne fait que révéler la finalité déloyale de cette divulgation, mais c’est bien l’acte de transmission qui est au cœur du comportement fautif.
Cette approche soulève une autre question tout aussi importante : celle du préjudice réparable. La simple obtention ou détention d’informations confidentielles, sans utilisation effective, cause-t-elle nécessairement un préjudice à la victime ? Pas nécessairement. On pourrait imaginer qu’un ancien salarié ou un ancien mandataire détienne des informations confidentielles sans jamais les utiliser, soit par oubli, soit parce qu’elles se révèlent finalement inutiles à son activité. Dans une telle hypothèse, la faute serait caractérisée selon la jurisprudence actuelle, mais le préjudice pourrait être inexistant ou très difficile à démontrer.
Cette difficulté ne conduit cependant pas nécessairement au rejet de l’action en responsabilité civile. En effet, il est possible de solliciter, non pas une mesure de réparation par équivalent sous forme de dommages et intérêts, mais une réparation en nature. L’article L. 152-3 du Code de commerce, applicable en matière de secret des affaires, prévoit ainsi diverses mesures d’interdiction, de destruction et de rappel des circuits commerciaux. Par analogie, le juge pourrait ordonner la suppression ou la destruction du contenu protégé, la restitution des documents confidentiels, ou encore l’interdiction d’utiliser ces informations à l’avenir. De telles mesures permettraient de faire cesser la situation illicite résultant de la simple détention d’informations confidentielles, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice chiffrable. Cette approche présenterait l’avantage de la cohérence avec la conception objective de la faute adoptée par la Cour de cassation, tout en évitant les difficultés pratiques de preuve du préjudice dans les cas où aucune utilisation effective des informations n’est démontrée.
Toutefois, dans les hypothèses où une réparation par équivalent serait sollicitée, la question des modalités d’évaluation du préjudice demeure entière. L’article L. 152-6 du Code de commerce prévoit en effet que, pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi, la juridiction prend en considération, notamment, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte. Cette disposition permet une approche originale de la réparation qui ne se fonde pas uniquement sur le préjudice subi par la victime, mais également sur l’avantage injustement obtenu par l’auteur de la faute.
Or, en l’absence d’application de la loi de 2018, on pourrait envisager de faire application de la jurisprudence Cristal de Paris rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2020 (Com., 12 février 2020, n° 17-31.614). Cette jurisprudence énonce que si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût. Ces actes permettent à leur auteur de s’épargner une dépense en principe obligatoire et induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu.
La jurisprudence Cristal de Paris admet donc que, lorsque tel est le cas, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Cette approche présente une similitude frappante avec celle retenue par l’article L. 152-6 du Code de commerce pour la violation du secret des affaires.
En l’espèce, l’application de cette jurisprudence permettrait, y compris au stade du préjudice, de s’inspirer de l’esprit de l’article L. 152-6 du Code de commerce. Le vice-président de l’association qui a communiqué les informations confidentielles à son futur associé leur a permis de s’épargner certains investissements intellectuels et matériels dans la création de leur festival concurrent. Ils ont bénéficié d’une connaissance de l’équilibre financier de l’association Super VW Festival qui leur a donné un avantage concurrentiel indu, même si cet avantage peut être difficile à quantifier précisément. Plutôt que de s’attacher uniquement au préjudice subi par l’association, qui pourrait être malaisé à établir, la juridiction pourrait évaluer les dommages et intérêts en prenant en considération l’avantage injustement obtenu par les créateurs de la société Motorfest grâce à la détention de ces informations confidentielles.
Cette approche présenterait l’avantage de la cohérence entre le régime de la faute, inspiré par les principes de la loi de 2018, et le régime de la réparation, qui s’inspirerait lui aussi de l’esprit de cette loi par le biais de la jurisprudence Cristal de Paris. Elle permettrait également de surmonter la difficulté pratique de la preuve du préjudice dans les hypothèses où, comme en l’espèce, le caractère confidentiel de l’information suffit à caractériser la faute, mais où le préjudice économique effectivement subi par la victime reste difficile à établir avec précision. Cette question devra être tranchée par la cour d’appel de renvoi qui sera saisie de l’affaire après la cassation, et il sera particulièrement intéressant d’observer quelle méthode d’évaluation du préjudice sera retenue.
B. L’extension aux salariés et aux mandataires d’associations
L’aspect le plus remarquable de cette décision réside peut-être moins dans le principe qu’elle consacre que dans la formulation qu’elle retient et dans son champ d’application. En effet, la Cour de cassation vise expressément tant l’ancien salarié que l’ancien mandataire social d’un concurrent, alors même qu’en l’espèce il ne s’agissait que d’un ancien mandataire social d’une association. Cette formulation constitue manifestement un obiter dictum, c’est-à-dire une affirmation de principe qui dépasse les strictes nécessités de la solution du litige.
Cette extension mérite une attention particulière car elle unifie dans une même règle deux situations qui, traditionnellement, relèvent de régimes juridiques distincts. Le salarié est lié à son employeur par un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination et soumis aux dispositions du Code du travail. Le mandataire social, quant à lui, exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat régi par les articles 1984 et suivants du Code civil et, pour les sociétés, par les dispositions spécifiques du Code de commerce. Ces deux situations juridiques appellent des obligations de loyauté de nature et d’intensité différentes.
S’agissant du salarié, la jurisprudence a progressivement construit un régime d’obligation de loyauté qui trouve sa source dans l’exécution de bonne foi du contrat de travail. Cette obligation se prolonge, dans une certaine mesure, après la cessation du contrat de travail, notamment par le jeu des clauses de non-concurrence. Le Memento Social de Francis Lefebvre recense d’ailleurs les différentes fautes susceptibles d’être commises par le salarié et justifiant son licenciement, parmi lesquelles figure l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à l’employeur. La jurisprudence sociale a ainsi progressivement établi que le salarié ne peut ni utiliser ni divulguer les informations confidentielles auxquelles il a eu accès dans le cadre de ses fonctions, cette obligation persistant après la rupture du contrat de travail.
En incluant expressément le salarié dans la règle qu’elle énonce, la Cour de cassation opère donc une transposition des principes du droit du travail vers le droit de la concurrence. Cette démarche n’est pas neutre, car elle implique que la simple détention par un salarié d’informations confidentielles de son ancien employeur, lorsqu’il crée ou participe à la création d’une société concurrente, constitue ipso facto un acte de concurrence déloyale, indépendamment de toute utilisation effective de ces informations. Cette solution va au-delà de ce que la jurisprudence sociale avait jusqu’à présent consacré, puisqu’elle fait de la détention elle-même, et non de l’utilisation ou de la divulgation, le fait générateur de responsabilité.
Le parallèle avec le mandataire social est tout aussi instructif. Le mandataire social, dirigeant d’une société, est soumis à une obligation fiduciaire particulièrement intense envers la société qu’il représente. Cette obligation de loyauté, fondement traditionnel de la responsabilité des dirigeants sociaux, implique qu’il ne peut poursuivre d’intérêt personnel contraire à celui de la société et qu’il doit agir dans l’intérêt social. La jurisprudence a depuis longtemps admis que cette obligation perdurait dans une certaine mesure après la cessation des fonctions, notamment en ce qui concerne l’exploitation d’informations confidentielles acquises durant l’exercice du mandat.
En unifiant sous une même règle le salarié et le mandataire social, la Cour de cassation suggère donc que c’est la situation fiduciaire, entendue au sens large, qui fonde l’interdiction. Qu’il s’agisse d’un contrat de travail ou d’un mandat social, la personne qui a eu accès à des informations confidentielles en raison de la confiance qui lui était accordée ne peut se prévaloir de ces informations pour concurrencer celui qui les lui a confiées. Cette approche unifiée présente l’avantage de la cohérence et de la simplicité, mais elle soulève aussi la question de savoir si d’autres situations fiduciaires ne devraient pas être soumises au même régime, comme celle du sous-traitant, du consultant ou du bénéficiaire d’un contrat de franchise.
L’autre aspect novateur de cette décision réside dans le fait qu’elle concerne un dirigeant d’association et non un mandataire social de société commerciale. Cette extension mérite une analyse approfondie car elle marque une évolution significative du droit applicable aux associations. Traditionnellement, le devoir de loyauté du mandataire social a été développé et affiné dans le cadre du droit des sociétés. Ce devoir de loyauté impose au dirigeant de ne pas poursuivre d’intérêt personnel contraire à l’intérêt social et de s’abstenir de toute activité concurrente susceptible de nuire à la société.
Or, dans le cas d’espèce, il s’agissait d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le vice-président en exerçait les fonctions dirigeantes. Les associations ne sont pas des sociétés et ne poursuivent pas un but lucratif au sens du droit des sociétés. Leur objet est désintéressé, même si elles peuvent exercer des activités économiques accessoires. La question se posait donc de savoir si les règles développées pour les dirigeants de sociétés pouvaient s’appliquer aux dirigeants d’associations.
La Cour de cassation répond positivement à cette question en appliquant le même régime de responsabilité au vice-président de l’association. Cette solution peut être fondée sur les articles 1991, 1992 et 1993 du Code civil qui régissent le mandat.
Cette solution présente néanmoins une particularité importante. Alors que le devoir de loyauté des dirigeants de sociétés a été traditionnellement développé dans le cadre de la responsabilité interne du dirigeant envers la société, la Cour de cassation applique ici ce devoir dans le cadre de la concurrence déloyale, c’est-à-dire dans les relations externes entre concurrents. Cette transposition du devoir de loyauté de la sphère interne vers la sphère externe n’est pas anodine. Elle signifie que la violation par le dirigeant d’association de son obligation de loyauté envers l’association peut constituer, dans le même temps, un acte de concurrence déloyale envers cette dernière lorsqu’elle exerce des activités économiques susceptibles de générer une concurrence.
L’association Super VW Festival organisait des festivals automobiles et se trouvait donc dans une situation de concurrence avec d’autres organisateurs de manifestations similaires. En ce sens, elle pouvait invoquer le bénéfice de la législation sur la concurrence déloyale. Mais cette situation reste relativement spécifique, car toutes les associations ne se trouvent pas dans une situation de concurrence économique. La portée de cette jurisprudence pour les associations purement désintéressées reste donc à préciser.