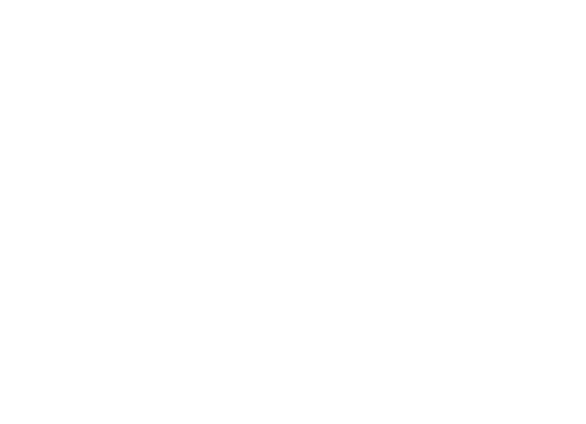Cass. Crim, 14 octobre 2025, n°24-86.603
La diffamation publique, qualification pénale emblématique du droit de la presse, soulève d’importantes questions quant à la détermination de la personne visée par les propos incriminés ; condition essentielleà la caractérisation de cette infraction.
Définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la répression de la diffamation vise à protéger l’honneur et la considération des personnes. Ainsi, seule l’allégation ou l’imputation d’un fait précis, de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, et qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire.
Parmi les éléments constitutifs susvisés l’exigence d’identification de la personne visée occupe une place déterminante ; la diffamation ne pouvant être envisagée que si les propos litigieux permettent de relier le fait imputé, directement ou indirectement, à une personne identifiable.
En l’espèce, le maire d’une commune avait publié sur un réseau social un message critiquant une opposante politique, présentée comme « l’ancienne collaboratrice parlementaire de l’ex-député-maire », laquelle aurait insulté et provoqué des agents municipaux. L’ancienne assistante parlementaire, s’était reconnue dans cette description et avait déposé plainte pour diffamation publique envers un particulier.
Après avoir été condamné en première instance, la cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 16 octobre 2024, a prononcé la relaxe du maire au motif que les propos incriminés visaient « l’ancienne collaboratrice parlementaire de l’ex-député-maire », ne mentionnaient jamais son nom et ne contenaient aucune information permettant de l’identifier. Les juges ont en outre relevé que la plaignante ne démontrait pas avoir été l’unique collaboratrice de l’ancien député-maire, ni être connue comme telle, ce qui rendait trop incertaine son identification.
La question se posait alors de savoir si la diffamation publique peut être retenue lorsque les propos litigieux ne désignent pas nommément la personne visée et, au surtout, ne permettent pas de l’identifier avec certitude.
La Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt du 14 octobre 2025. Elle retient que « lorsque les imputations ont été formulées sous une forme allusive ou déguisée de manière à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour agir en diffamation ».
Par cette décision, la chambre criminelle reconnaît la possibilité d’une identification plurielle (I) tout en consacrant une approche plus subjective du critère fondée sur la perception légitime de la personne visée (II).
I. Un droit d’agir pluriel en cas d’imputation susceptible de viser plusieurs personnes
Pour pouvoir engager une action sur le fondement du droit pénale de la presse, la victime, lorsqu’elle n’est pas expressément nommée, doit démontrer son identification à travers les propos incriminés.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 évoque cette question en affirmant qu’il y a diffamation même si l’imputation « vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes » de l’écrit incriminé.
Si les juges peuvent s’appuyer sur « des circonstances extrinsèques et claires et confirmant cette désignation de manière à la rendre évidente », encore faut-il que le délit vise une personne identifiable.
Le principe d’une identification indirecte ou allusive était donc acquis.
En revanche, la décision du 14 octobre 2025, tout en s’inscrivant dans la droite ligne du cadre légal et jurisprudentiel existant, étant sa portée en considérant que, lorsqu’un propos diffamatoire laisse planer un soupçon sur plusieurs personnes, chacune d’entre elles a qualité pour agir. Autrement formulé, même si le propos incriminé ne permet pas de déterminer précisément laquelle des collaboratrices parlementaires était visée, la pluralité des personnes potentiellement concernées n’exclut pas leur droit d’agir.
En censurant la cour d’appel qui, à l’inverse, avait exigé la preuve d’une identification certaine – au motif que le nom de la plaignante n’était pas mentionné et qu’elle ne démontrait pas avoir été l’unique collaboratrice du député concerné – la Cour de cassation ouvre la voie d’une interprétation extensive des éléments constitutifs de la diffamation.
Une telle interprétation prétorienne est peu courante en la matière, le droit de la presse étant guidé par un souci accru de protection de la liberté d’expression et donc une interprétation restrictive des conditions permettant de saisir le juge pénal. Les requérants invoquant cette solution seront assurément nombreux et des arrêts en précisant les contours sont à prévoir.
D’aucuns considéreront que cette précision revêt toutefois une importance particulière à l’ère des réseaux sociaux où un message évoquant un statut, un rôle ou une fonction peut suffire à identifier la personne visée, sans qu’il soit nécessaire de la nommer explicitement.
Plus étonnant encore, pour admettre qu’une identification plurielle ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action, la chambre criminelle a choisi de se fonder sur une appréciation subjective de la condition tenant à l’imputation du fait diffamatoire.
II. Vers une approche subjective de l’identification de la personne diffamée
La décision du 14 octobre 2025 consacre une approche « subjective » du critère d’identification : la qualité pour agir en diffamation ne dépend plus seulement de la capacité du public à reconnaître la victime, mais aussi de la perception légitime qu’elle peut avoir d’être visée.
La chambre criminelle considère ici que la plaignante a pu s’estimer visée dès lors qu’elle était l’une des collaboratrices parlementaires successives de l’ancien député-maire concerné.
L’identification n’est donc plus une donnée exclusivement « objective » ou « extérieure » au ressenti de la partie civile : il importe désormais que la personne se reconnaisse légitimement dans le propos litigieux, traduisant une volonté de protection de la réputation des individus face à des atteintes de plus en plus diffuses.
Cette subjectivisation s’inscrit ainsi dans une dynamique de rééquilibrage du droit de la presse à l’ère numérique. Elle semble illustrer la volonté de la Cour de préserver la cohérence du dispositif répressif issu de la loi de 1881, tout en adaptant son interprétation aux réalités contemporaines de la communication.
L’approche retenue appelle néanmoins certaines précisions de nature à mesurer sa portée.
D’une part, si la Cour admet qu’un propos puisse viser plusieurs personnes, elle ne dispense pas pour autant la partie poursuivante de démontrer l’existence d’une atteinte effective à son honneur ou à sa considération.
D’autre part, il est de jurisprudence constante que l’action est réservée aux victimes directes, c’est-à-dire que, non seulement les propos incriminés doivent viser une personne identifiable mais c’est encore uniquement cette personne directement visée, et elle seule, qui peut engager la procédure. De même, il est acquis qu’« une diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues ». Il ne saurait par exemple y avoir d’assimilation entre une personne morale et les personnes physiques qui la composent, une diffamation envers une société ne s’étendant pas à ses dirigeants, et vice-versa.
***
Résumé : La Cour de cassation précise la portée de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 en affirmant qu’une imputation, même formulée de manière allusive ou déguisée, peut viser plusieurs personnes sans faire obstacle à l’exercice d’une action en diffamation par chacune d’entre elles. En reconnaissant la légitimité pour chacun de s’estimer visé, elle confère au critère d’identification une dimension subjective, adaptée à l’évolution des modes de communication.