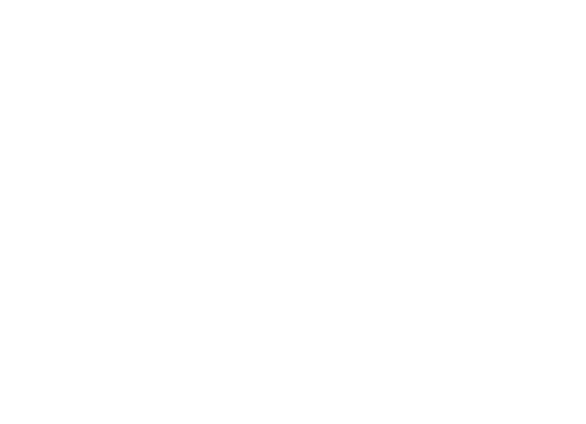L’évolution de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de fusion-absorption constitue l’une des problématiques les plus délicates du droit pénal des affaires contemporain. Cette question, qui interroge les fondements mêmes de la personnalité juridique et de ses conséquences procédurales, trouve ses racines dans les débats doctrinaux qui ont accompagné l’émergence de la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal de 1994.
L’histoire de cette reconnaissance révèle une trajectoire complexe, marquée par des hésitations significatives. L’avant-projet de 1978 avait initialement circonscrit cette responsabilité aux seuls groupements ayant une activité commerciale, industrielle ou financière, excluant délibérément les associations et syndicats au motif de préserver certains droits constitutionnels, notamment les droits d’association et de grève. Cette restriction, critiquée pour son caractère discriminatoire, fut progressivement abandonnée au profit d’une conception plus égalitaire, consacrée par l’avant-projet de juin 1983 qui étendit la responsabilité pénale à toutes les personnes morales, sans distinction de nature.
Cependant, la question du transfert de cette responsabilité en cas d’opérations de restructuration sociétaire demeura longtemps irrésolue. La jurisprudence de la chambre criminelle, jusqu’au revirement historique du 25 novembre 2020 (Crim. 25 nov. 2020, n° 18-86.955), s’opposait fermement à toute transmission de responsabilité pénale de la société absorbée vers la société absorbante, au nom du principe fondamental de personnalité des peines. Cette position, réaffirmée constamment depuis l’arrêt du 20 juin 2000 (Crim. 20 juin 2000, n° 99-86.742) puis consolidée par la décision du 14 octobre 2003 (Crim. 14 oct. 2003, Bull. crim. n° 189), créait néanmoins une tension avec le droit européen, particulièrement après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mars 2015 (CJUE 5 mars 2015, aff. C-343/13) qui avait imposé une approche contraire. Cette résistance jurisprudentielle fut encore réitérée par l’arrêt du 25 octobre 2016 (Crim. 25 oct. 2016, n° 16-80.366) et précisée par la décision du 7 janvier 2020 (Crim. 7 janv. 2020, n° 18-86.293) qui consacrait l’extinction de l’action publique en cas de fusion-absorption.
Le revirement de 2020 (Crim. 25 nov. 2020, n° 18-86.955) opéra une révolution conceptuelle en admettant que la continuité économique et fonctionnelle entre société absorbée et société absorbante justifiait la transmission de la responsabilité pénale. Cette évolution jurisprudentielle, motivée par la nécessité d’éviter que les fusions constituent des instruments d’échappement aux conséquences pénales, fut précisée par les arrêts ultérieurs du 13 avril 2022 (Crim. 13 avr. 2022, n° 21-80.653) et du 22 mai 2024 (Crim. 22 mai 2024, n° 23-83.180), soulevant immédiatement des interrogations procédurales complexes, dont l’arrêt du 29 avril 2025 (Crim. 29 avr. 2025, n° 24-81.555) constitue une illustration remarquable.
La décision commentée s’inscrit dans cette dynamique évolutive en précisant les modalités procédurales de mise en œuvre du transfert de responsabilité pénale, particulièrement s’agissant de l’effet dévolutif de l’appel et des exigences de motivation des sanctions prononcées à l’encontre de la société absorbante. Elle révèle la sophistication technique que requiert désormais l’articulation entre droit des sociétés et procédure pénale dans le contexte des opérations de fusion-absorption.
I. L’extension de l’effet dévolutif de l’appel aux dispositions concernant la société absorbée
L’arrêt du 29 avril 2025 tranche une question procédurale d’une complexité remarquable, née de la confrontation entre le principe de transmission universelle de patrimoine inhérent aux opérations de fusion-absorption et les règles classiques de la procédure pénale relatives à l’effet dévolutif de l’appel. La solution retenue par la chambre criminelle témoigne d’une approche pragmatique qui privilégie la cohérence systémique sur la rigueur formaliste traditionnelle.
La problématique procédurale soulevée présentait une acuité particulière. La société absorbée, ayant perdu sa personnalité juridique par l’effet de la fusion-absorption réalisée le 30 septembre 2021, se trouvait dans l’impossibilité de former appel du jugement de condamnation rendu le 23 septembre 2021. Cette incapacité procédurale, résultant mécaniquement de la disparition de sa personnalité juridique, aurait normalement dû conduire à considérer comme définitives les dispositions du jugement de première instance la concernant.
Toutefois, la société absorbante avait elle-même interjeté appel du jugement, sans limitation apparente quant à son objet. La question centrale résidait alors dans la détermination de l’étendue de cet appel : devait-il être interprété comme se limitant aux seules dispositions concernant personnellement la société absorbante, ou s’étendait-il également aux dispositions relatives à la société absorbée, en vertu du principe de transmission universelle de patrimoine ?
La Cour de cassation apporte une réponse catégorique en faveur de la seconde interprétation, s’appuyant sur l’article 509 du code de procédure pénale qui dispose que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant. La haute juridiction rappelle avec fermeté que, en cas de contestation sur l’étendue de la saisine, c’est au seul vu de l’acte d’appel qu’il appartient à la juridiction du second degré de se déterminer, les limitations et restrictions devant ressortir nettement des termes mêmes de l’acte d’appel.
Cette solution procédurale révèle une conception extensive de l’effet dévolutif de l’appel, adaptée aux réalités du droit des sociétés contemporain. En considérant que la société absorbante, venue aux droits de la société absorbée par l’effet de la transmission universelle de patrimoine, peut exercer les droits processuels de cette dernière sans limitation explicite, la Cour de cassation consacre une approche unitaire de la personnalité juridique dans le contexte des opérations de restructuration.
Cette interprétation s’avère d’autant plus remarquable qu’elle opère une synthèse harmonieuse entre les exigences du droit commercial et celles de la procédure pénale. Elle évite la création d’une zone d’impunité procédurale qui aurait résulté de l’impossibilité pour la société absorbée d’exercer ses voies de recours, tout en respectant la logique civiliste de la transmission universelle de patrimoine. La décision témoigne ainsi d’une approche systémique du droit, privilégiant la cohérence d’ensemble sur l’autonomie traditionnelle des branches juridiques.
II. Les exigences renforcées de motivation dans le prononcé des sanctions
L’arrêt du 29 avril 2025 ne se contente pas de résoudre la question procédurale de l’effet dévolutif de l’appel ; il énonce également des directives précises quant aux exigences de motivation que devront respecter les juridictions du fond lorsqu’elles prononceront des sanctions à l’encontre d’une société absorbante pour des faits commis tant par elle-même que par la société absorbée. Ces prescriptions révèlent la sophistication juridique qu’exige désormais l’application du principe de transfert de responsabilité pénale en cas de fusion-absorption.
La complexité de la situation procédurale née du transfert de responsabilité pénale impose en effet une approche renouvelée de l’individualisation de la peine. Lorsqu’une société absorbante peut être condamnée pour des faits commis par deux entités juridiques distinctes – elle-même et la société absorbée -, les critères traditionnels d’appréciation de la sanction pénale doivent être repensés pour tenir compte de cette dualité originelle.
La Cour de cassation impose ainsi aux juridictions de renvoi de motiver leur décision « au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité, de la situation personnelle de chacune des deux sociétés au moment des faits et postérieurement ». Cette exigence de motivation différenciée constitue une innovation procédurale significative, qui traduit la nécessité d’adapter les mécanismes traditionnels de l’individualisation de la peine aux réalités complexes des opérations de restructuration sociétaire.
L’originalité de cette approche réside dans sa dimension temporelle duale. Les juridictions devront ainsi apprécier la situation des deux sociétés non seulement au moment des faits – période où elles constituaient des entités juridiques distinctes -, mais également postérieurement, c’est-à-dire après la réalisation de l’opération de fusion-absorption. Cette double temporalité révèle la subtilité conceptuelle que requiert l’application du transfert de responsabilité pénale, qui ne saurait faire abstraction des particularités propres à chaque entité juridique impliquée.
L’exigence de prise en compte des « ressources et des charges de la société absorbante au moment où la juridiction statue » témoigne par ailleurs d’une approche réaliste de l’individualisation de la peine pécuniaire. En imposant aux juges de considérer la situation financière de la seule société subsistante, la Cour de cassation évite les difficultés pratiques qui auraient résulté d’une appréciation fondée sur des patrimoines désormais confondus, tout en préservant l’effectivité de la sanction pénale.
Cette sophistication procédurale révèle l’émergence d’un nouveau paradigme dans l’articulation entre droit pénal et droit des sociétés. Elle témoigne de la capacité d’adaptation du système juridique français aux évolutions du monde économique contemporain, caractérisé par une multiplication des opérations de restructuration sociétaire. En imposant ces exigences renforcées de motivation, l’arrêt du 29 avril 2025 contribue à l’élaboration d’un cadre procédural cohérent et opérationnel pour l’application du principe de transfert de responsabilité pénale, consolidant ainsi l’acquis jurisprudentiel du revirement de 2020.
L’arrêt du 29 avril 2025 s’inscrit donc dans la continuité de l’évolution jurisprudentielle amorcée par le revirement de novembre 2020, tout en apportant les précisions procédurales indispensables à sa mise en œuvre effective. Il témoigne de la maturité acquise par la jurisprudence pénale dans l’appréhension des opérations de fusion-absorption et de sa capacité à concilier les exigences de la répression pénale avec les réalités du droit des affaires contemporain. Cette décision constitue ainsi une étape supplémentaire dans l’édification d’un corpus jurisprudentiel cohérent et adapté aux défis que pose l’articulation entre responsabilité pénale et restructurations sociétaires.