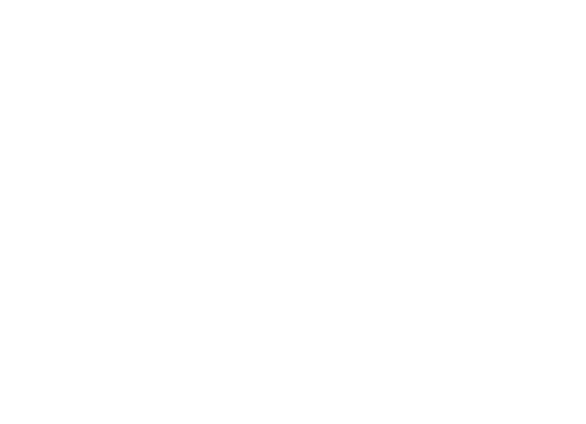Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 23-20.471
L’administration provisoire constitue, dans l’arsenal des mesures conservatoires susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés, l’une des interventions les plus significatives dans la vie sociale. Cette institution, née de la création jurisprudentielle et progressivement affinée par la pratique judiciaire, procède d’une logique de sauvegarde de l’intérêt social lorsque celui-ci se trouve exposé à un péril imminent en raison du dysfonctionnement des organes sociaux. Ainsi que l’enseigne la doctrine, l’administrateur provisoire peut être défini comme « la personne désignée par l’autorité judiciaire en vue d’assurer, à titre temporaire, la gestion d’une personne morale, civile ou commerciale, et, parallèlement, de s’efforcer de résoudre la crise ayant motivé sa désignation » (B. LECOURT, « Administrateur provisoire », Rép. sociétés, juin 2018, n° 2). Cette intervention judiciaire, qui constitue une dérogation remarquable au principe de souveraineté des associés, trouve son fondement dans la nécessité de préserver l’intérêt social contre les défaillances susceptibles de compromettre la pérennité de l’entreprise sociétaire.
Le caractère exceptionnel de cette mesure explique que la jurisprudence ait progressivement défini des conditions strictes à sa mise en œuvre. Ainsi que le rappelle constamment la Cour de cassation, « la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent » (Cass. com., 25 janv. 2005, n° 00-22.457, Rev. sociétés 2005. 828, note B. Lecourt). Cette exigence de conditions cumulatives témoigne de la volonté jurisprudentielle d’éviter que cette institution ne devienne un instrument de gouvernement judiciaire des sociétés, susceptible de porter atteinte à l’autonomie de la volonté contractuelle qui sous-tend le pacte social.
Au-delà de ces conditions de fond, se pose la question, non moins délicate, de la détermination des personnes habilitées à solliciter une telle mesure. Cette problématique, qui touche aux fondements mêmes de l’action en justice et à l’articulation entre intérêt personnel et intérêt social, a récemment fait l’objet d’importantes précisions jurisprudentielles, dont témoigne l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 mai 2025.
L’espèce soumise à la Haute juridiction présentait une configuration contentieuse particulièrement révélatrice des enjeux en présence. Deux sociétés, appartenant à un même groupe, reprochaient à leur ancien dirigeant des détournements de fonds au profit d’une société par actions simplifiée dont ce dernier assumait également la présidence. Ces sociétés, après avoir engagé des poursuites pénales et civiles contre la société par actions simplifiée et son dirigeant et obtenu des saisies conservatoires sur leurs actifs, avaient sollicité du juge des référés la nomination d’un administrateur chargé de gérer provisoirement ladite société. Si cette demande avait dans un premier temps été accueillie, la cour d’appel saisie en rétractation avait annulé l’ordonnance initiale, estimant que les conditions de paralysie de la société et de péril imminent n’étaient pas caractérisées.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre cette décision, a choisi de fonder sa solution sur un motif distinct de celui retenu par les juges du fond. Plutôt que de s’engager dans l’examen des conditions substantielles de la mesure, elle a privilégié une approche procédurale en déclarant que « le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci». Cette formulation, d’une netteté remarquable, tranche définitivement une question qui avait pu susciter quelques incertitudes dans la jurisprudence antérieure et s’inscrit dans un mouvement plus large de clarification des contours de l’institution.
L’intérêt de cette décision dépasse largement le cadre de l’espèce qui l’a vu naître. En affirmant l’incompatibilité de principe entre la qualité de créancier et le droit de solliciter la nomination d’un administrateur provisoire, la Cour de cassation opère une clarification bienvenue de la summa divisio entre les personnes ayant vocation à actionner ce mécanisme de protection et celles qui en demeurent exclues. Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans la continuité d’une réflexion plus générale sur les fondements de l’administration provisoire, mérite d’être analysée tant dans ses fondements théoriques que dans ses implications pratiques pour le contentieux des sociétés en difficulté.
I. L’affirmation d’une incompétence de principe des créanciers
La solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 7 mai 2025 procède d’une analyse renouvelée de la distinction fondamentale entre la qualité pour agir et l’intérêt à agir en matière d’administration provisoire. Cette approche, qui privilégie une conception restrictive de l’accès à cette mesure exceptionnelle, témoigne d’une volonté de préserver l’autonomie de la société contre les ingérences extérieures susceptibles de compromettre l’exercice normal de la souveraineté des associés.
L’exclusion des créanciers du champ des demandeurs habilités à solliciter la nomination d’un administrateur provisoire repose sur une analyse substantielle de la finalité même de cette institution. Ainsi que le souligne avec force la doctrine autorisée, « la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas une mesure destinée à garantir les droits des créanciers sociaux » (B. LECOURT, « Administrateur provisoire », Rép. sociétés, juin 2018, n° 99). Cette conception s’enracine dans la reconnaissance de ce que « les créanciers sociaux ne peuvent s’immiscer dans les affaires sociales » et « ne peuvent se faire juge de la préservation des intérêts sociaux » (ibid., n° 97). Une telle restriction procède de la nature même de la relation créancière, laquelle, par essence, place le créancier dans une position d’extériorité par rapport à la société débitrice.
Cette logique d’exclusion trouve sa justification première dans la distinction conceptuelle entre l’intérêt social et les intérêts particuliers des créanciers. Alors que l’administration provisoire vise exclusivement à la sauvegarde du premier, l’action des créanciers procède naturellement de la défense de leurs intérêts patrimoniaux propres.
Cette divergence d’objectifs explique, selon la formule éclairante de Benoît Lecourt, que « les créanciers sociaux ne peuvent s’immiscer dans les affaires sociales ; ils ne peuvent se faire juge de la préservation des intérêts sociaux. De plus, ces derniers ont en vue un intérêt strictement personnel » (loc. cit.). La Cour de cassation, en consacrant cette incompatibilité de principe, reconnaît implicitement que l’exercice par les créanciers d’un droit de regard sur la gestion sociale par le biais de l’administration provisoire risquerait de dénaturer cette institution en la transformant en un instrument de pression au service d’intérêts privés.
L’arrêt du 7 mai 2025 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà ancienne qui avait esquissé cette solution. L’arrêt de la chambre commerciale du 14 février 1989 (n° 87-13.719, JCP E 1989. II. 15517, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain ; Bull. Joly 1989. 323, note Y. Streiff ; Rev. sociétés 1989. 633, note D. Randoux) avait déjà retenu l’irrecevabilité d’une demande de nomination d’administrateur provisoire formée par un créancier, mais en mobilisant une motivation composite qui mêlait conditions de fond et conditions de recevabilité. La Haute juridiction avait alors considéré que le fonctionnement de la société était normal et qu’elle ne rencontrait pas de difficultés financières, tout en précisant « qu’il n’appartenait pas au créancier de former une telle demande au motif que la carence des dirigeants menaçait ses intérêts et qu’il ne lui appartenait pas non plus de se faire juge des intérêts de la société et de ses associés et d’agir en leur nom pour les préserver ». La décision de 2025 présente l’avantage d’une motivation épurée qui isole la question de la qualité pour agir de celle des conditions substantielles de la mesure.
Cette clarification jurisprudentielle revêt une importance particulière au regard de l’évolution récente de la jurisprudence en matière de qualité pour agir. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 22 janvier 2025 (n° 22-20.526) avait posé le principe selon lequel « toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire », tout en précisant que cette demande était « subordonnée à la démonstration que l’intéressé n’agit pas dans son pur intérêt personnel ». Cette formulation aurait pu laisser entendre que l’existence d’un intérêt légitime suffisait à conférer la qualité pour agir, sous réserve de la finalité poursuivie. L’arrêt du 7 mai 2025 démontre que cette approche doit être nuancée et que certaines catégories de personnes demeurent par principe exclues du droit d’agir, indépendamment de la finalité qu’elles poursuivent.
La logique sous-jacente à cette exclusion procède également d’une analyse pragmatique des risques que ferait peser sur la vie sociale une extension inconsidérée du droit des créanciers à solliciter l’administration provisoire. En effet, les créanciers peuvent avoir des intérêts opposés à ceux de la société et pourraient voir dans la désignation d’un administrateur provisoire un moyen de pression pour le paiement de leur créance. Cette préoccupation témoigne d’une juste appréciation des enjeux économiques et juridiques en présence : l’administration provisoire, en raison de son caractère spectaculaire et de ses conséquences sur l’image de la société, pourrait aisément être détournée de sa finalité première pour devenir un instrument de contrainte au service de créanciers impatients.
Cette approche restrictive s’inscrit dans la droite ligne des enseignements de la doctrine qui avait très tôt souligné que l’intervention du juge dans la vie sociale devait demeurer exceptionnelle (J. MESTRE, « Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés », RJ com. 1985. 81 ; M. JEANTIN, « Le rôle du juge en droit des sociétés », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs, Mélanges R. Perrot, 1996, Dalloz, p. 149). L’exclusion des créanciers participe ainsi d’une démarche de préservation de l’autonomie contractuelle qui constitue l’un des piliers fondamentaux du droit des sociétés.
II. Les répercussions contentieuses de cette restriction
L’affirmation de l’incompétence de principe des créanciers pour solliciter la nomination d’un administrateur provisoire produit des effets qui dépassent largement le cadre de cette catégorie particulière de demandeurs. Cette évolution jurisprudentielle, tout en apportant une clarification salutaire à une question jusqu’alors incertaine, soulève de nouvelles interrogations quant aux contours futurs de l’accès à cette mesure exceptionnelle.
La portée pratique de cette restriction mérite d’être appréciée au regard des alternatives dont disposent les créanciers pour protéger leurs intérêts face à une gestion sociale défectueuse.
Comme le rappelle justement un auteur, « les créanciers sociaux disposent d’autres moyens pour se faire payer. Si la société a omis d’exercer certains droits, ils peuvent exercer l’action oblique. Si elle s’est appauvrie volontairement, ils peuvent recourir à l’action paulienne » (B. LECOURT, « De l’utilité de l’action paulienne en droit des sociétés », Mélanges Y. Guyon, 2003, Dalloz, p. 615). À ces mécanismes de droit commun s’ajoutent les voies spécifiques du droit des entreprises en difficulté, notamment la possibilité de solliciter l’ouverture d’une procédure collective lorsque les conditions en sont réunies. Cette palette d’instruments juridiques démontre que l’exclusion des créanciers du bénéfice de l’administration provisoire ne les prive pas de tout recours contre une gestion sociale défaillante.
La solution retenue présente en outre l’avantage de clarifier les rapports entre l’administration provisoire et les autres mécanismes de contrôle de la gestion sociale. En excluant les créanciers de son champ d’application, cette institution conserve sa spécificité de mesure de sauvegarde de l’intérêt social, distincte des procédures visant à la protection d’intérêts particuliers. Cette clarification s’avère d’autant plus opportune que la multiplication des acteurs susceptibles d’intervenir dans la vie sociale risquait de brouiller les finalités respectives de ces différents mécanismes.
Cependant, cette évolution jurisprudentielle soulève des questions prospectives importantes quant à la définition des contours de la qualité pour agir en matière d’administration provisoire. L’arrêt du 7 mai 2025, en privilégiant une approche catégorielle plutôt qu’une analyse au cas par cas, invite à s’interroger sur le sort réservé à d’autres catégories de demandeurs potentiels dont le statut demeure incertain.
La situation des comités sociaux et économiques illustre parfaitement cette incertitude. Si l’arrêt de la chambre sociale du 23 octobre 2012 (n° 11-24.609, Bull. civ. V, n° 271 ; JCP E 2013. 1010, note Th. Lahalle) avait admis la recevabilité d’une telle demande, cette solution pourrait être remise en cause par l’évolution récente de la jurisprudence. La doctrine avait d’ailleurs relevé que « le rôle de plus en plus important conféré au comité social et économique par les textes récents, les principes de gouvernement d’entreprise qui confèrent aux salariés une place essentielle au sein de la société, devraient conduire à considérer que le comité puisse demander, dans tout groupement, la désignation d’un administrateur provisoire » (B. LECOURT, « Questions autour de l’administrateur provisoire », JCP E 2016. 1384, n° 13). De même, la cour d’appel de Paris avait reconnu dans un arrêt du 15 octobre 2021 (n° 20/07190) le droit d’agir en nomination d’un administrateur provisoire au comité social et économique d’une société, mais cette solution pourrait désormais faire l’objet d’un réexamen au regard des nouveaux critères dégagés par la Cour de cassation.
La question se pose également pour d’autres catégories de personnes dont l’intérêt à l’égard de la société revêt un caractère spécifique. Les obligataires, qui constituent une forme particulière de créanciers, pourraient-ils se prévaloir de leur statut distinct pour échapper à l’exclusion de principe posée par l’arrêt commenté ? La spécificité de leur relation avec la société émettrice, qui s’apparente davantage à une forme de participation qu’à une simple créance, pourrait justifier un traitement différencié. De même, le sort des salariés, dont l’intérêt à la pérennité de l’entreprise transcende leur simple qualité de créanciers de salaires, demeure incertain. La doctrine avait d’ailleurs suggéré que « si les salariés ont un intérêt légitime et s’ils établissent que les conditions de la désignation d’un administrateur sont réunies, leur demande devrait être recevable. Il en serait ainsi si leurs salaires n’étaient plus payés en raison de la paralysie de la société et de l’intérêt social exposé à un péril imminent » (B. LECOURT, op. cit., n° 96).
L’articulation entre l’arrêt du 7 mai 2025 et celui du 22 janvier précédent soulève également des interrogations méthodologiques importantes. Alors que ce dernier semblait privilégier une approche finaliste en exigeant la démonstration que le demandeur « n’agit pas dans son pur intérêt personnel », l’arrêt commenté adopte une logique catégorielle qui exclut a priori certaines personnes indépendamment de leurs motivations. Cette tension entre deux approches méthodologiques distinctes pourrait nécessiter de futurs arbitrages jurisprudentiels pour assurer la cohérence d’ensemble du système.
L’évolution de la jurisprudence relative aux personnes ayant un intérêt dans la société mérite également d’être interrogée. Si la doctrine classique avait posé que « ont un intérêt à agir toutes les personnes qui possèdent un intérêt dans la société : directeur général ; président du conseil d’administration ou gérant, membres du conseil d’administration » ainsi que « les porteurs de parts ou actionnaires, même si le requérant ne possède qu’un seul titre » (Y. GUYON, « Droit des affaires », t. 1er, 12e éd., 2003, Economica, n° 449 ; P. DIDIER et Ph. DIDIER, « Les sociétés commerciales », 2011, Economica, n° 469), l’évolution récente de la jurisprudence pourrait conduire à un réexamen de ces catégories traditionnellement admises.
Cette évolution soulève enfin la question plus générale de l’équilibre entre la protection de l’autonomie sociale et l’effectivité des mécanismes de contrôle de la gestion. Si l’exclusion des créanciers procède d’une logique légitime de préservation de la souveraineté des associés, elle ne doit pas conduire à une immunisation excessive de la société contre toute forme de contrôle externe. L’enjeu consiste dès lors à préserver un équilibre subtil entre ces exigences contradictoires, en définissant avec précision les catégories de personnes habilitées à actionner ce mécanisme de protection sans pour autant compromettre l’autonomie de la volonté contractuelle qui sous-tend le pacte social.