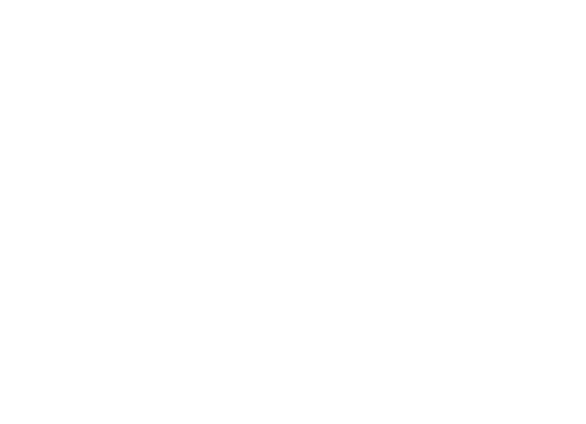Cass. 1re civ., 25 septembre 2024, n° 23-14.777
Le pacte de préférence s’inscrit dans la catégorie des avant-contrats, c’est-à-dire des contrats préparatoires en vue de la conclusion d’un contrat final. Il se distingue de la promesse unilatérale de vente ou du contrat de réservation par son mécanisme spécifique : il ne crée pas un engagement ferme de vendre, mais une priorité accordée à un bénéficiaire en cas de volonté du promettant de contracter. En ce sens, l’article 1123 du Code civil, tel qu’issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le définit comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. »
Très efficace dans la pratique, le pacte de préférence est fréquemment utilisé dans les baux commerciaux, les opérations immobilières ou encore les pactes d’actionnaires. Outil de préservation des intérêts, il reflète une volonté d’anticipation contractuelle. Cependant, cette efficacité juridique ne doit pas faire oublier que, comme tout engagement contractuel, le pacte de préférence se heurte à certaines limites, au premier rang desquelles figure la prohibition des engagements perpétuels.
C’est précisément sur cette problématique que la Cour de cassation s’est penchée dans un arrêt du 25 septembre 2024. L’occasion de rappeler que, si le pacte de préférence peut sembler anodin dans sa formulation, sa rédaction – et notamment la question de sa durée – revêt une importance capitale pour la sécurité juridique des parties.
I. LA PROHIBITION DE LA PERPÉTUITÉ DANS LES CONTRATS ET LES PACTES DE PRÉFÉRENCE
La liberté contractuelle, principe fondateur du droit des obligations, implique nécessairement la liberté de mettre fin à un contrat. À ce titre, l’article 1210 du Code civil prévoit explicitement que « les engagements perpétuels sont prohibés ». Cette règle, d’ordre public, vise à garantir qu’aucune partie ne puisse être liée de manière indéfinie sans faculté de se libérer.
Dès lors, soit un contrat prévoit un terme, soit il prévoit les modalités de résiliation contractuelles. À défaut, ce seront les dispositions légales qui s’imposeront aux contractants.
Il convient ici de bien distinguer le contrat perpétuel du contrat à durée indéterminée. Si le second n’a pas de terme fixé mais peut être résilié à tout moment par l’une des parties, le contrat perpétuel, lui, s’en distingue par le fait que cette résiliation est rendue impossible ou illusoire. En d’autres termes, la perpétuité s’analyse moins dans l’absence de durée que dans l’absence de faculté de rupture.
Dans le cadre du pacte de préférence, la question se pose de savoir si une absence de terme exprès peut rendre l’engagement perpétuel, donc illicite.
Avant la réforme de 2016, la jurisprudence avait déjà apporté une réponse pragmatique à cette question. Dans un arrêt du 7 mars 2006 (Civ. 1re, n° 04-12.914), la Cour de cassation a estimé qu’un engagement perpétuel ne devait pas nécessairement être annulé, mais pouvait parfois être requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette solution permettait de maintenir une certaine efficacité contractuelle tout en préservant la liberté des parties.
La réforme du droit des contrats de 2016, a repris cette solution à l’article 1210, alinéa 2, en énonçant que « chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ». L’article 1211 vient compléter cette disposition en précisant que, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation est possible à tout moment, sous réserve d’un préavis raisonnable ou fixé par les parties.
Autrement dit, la perpétuité est neutralisée par l’ouverture d’une faculté de résiliation unilatérale.
II. LA PORTÉE DE L’ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024 : UN CONTOURNEMENT PRAGMATIQUE DE LA PERPÉTUITÉ
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le pacte de préférence litigieux avait été conclu en 1990, donc bien avant l’entrée en vigueur des articles 1210 et 1211. Le promettant, souhaitant se dégager de son engagement, invoquait son caractère perpétuel, au motif que le pacte ne prévoyait aucun terme ni faculté de résiliation.
La Haute juridiction rejette cet argument : même si les textes issus de la réforme ne sont pas rétroactifs, leur logique peut s’appliquer à des situations contractuelles antérieures. En conséquence, le pacte de préférence est requalifié en contrat à durée indéterminée, et il peut donc être résilié unilatéralement.
Ainsi, la Cour confirme que l’absence de terme n’entraîne pas nécessairement la nullité du pacte : seule une faculté de résiliation doit être ouverte. Cette approche, inspirée par la volonté de sécurité juridique, évite aux parties de voir leur engagement annulé pour une simple carence rédactionnelle.
La Cour entend ainsi préserver l’édifice contractuel tout en palliant les imperfections de certains actes, le tout dans un esprit de non-immixtion.
Cette solution, si elle peut sembler favorable au promettant, révèle en réalité une certaine ambivalence. En effet, tant qu’il ne manifeste pas sa volonté de résilier, le pacte reste pleinement opposable. Autrement dit, l’engagement du promettant subsiste indéfiniment, non pas parce qu’il est perpétuel en droit, mais parce qu’il n’a pas été rompu en fait.
Le risque est donc que le promettant, mal informé, laisse courir un pacte de préférence sans y prêter attention, pour découvrir plusieurs années (voire décennies) plus tard que son engagement est toujours en vigueur.
Cette situation appelle à une vigilance accrue lors de la rédaction des pactes, mais également à un suivi actif des engagements contractuels.
III. ENJEUX PRATIQUES ET STRATÉGIQUES POUR LES PARTIES
La principale leçon de cet arrêt est la suivante : la perpétuité n’est plus une cause de nullité automatique, mais elle peut subsister dans les faits si le promettant n’exerce pas son droit de résiliation.
Il est donc vivement recommandé d’insérer un terme explicite au pacte de préférence. À défaut, une clause de résiliation unilatérale, accompagnée d’un préavis encadré, permettrait de sécuriser l’équilibre contractuel.
En l’absence de telles dispositions, le promettant s’expose à une insécurité juridique, son engagement pouvant lui être opposé à tout moment. À première vue, le bénéficiaire pourrait être tenté de préférer un pacte sans terme, dans l’idée d’une protection indéfinie. Pourtant, cette absence de terme le fragilise : dès lors que le pacte est analysé comme un contrat à durée indéterminée, le promettant pourra le résilier unilatéralement, avec un simple préavis raisonnable.
Là encore, un terme permettrait d’assurer, au mieux, la sécurité des opérations en cause et éviter tout litige futur.
Pour garantir une certaine stabilité, il est donc dans l’intérêt du bénéficiaire d’encadrer la durée du pacte, quitte à fixer un terme éloigné (par exemple : 30 ans, ou la durée de vie d’un associé, …). Cette durée définie empêche le promettant de se délier trop facilement et renforce l’effectivité de la priorité accordée.
***
Le pacte de préférence, par son apparente simplicité, cache des enjeux contractuels majeurs. L’arrêt du 25 septembre 2024 vient opportunément rappeler que la perpétuité, en matière contractuelle, n’est plus une cause de nullité en soi, mais qu’elle appelle à une vigilance rédactionnelle accrue.
Promettants et bénéficiaires doivent donc veiller à insérer un terme clair, ou à défaut, des modalités de résiliation précises, pour sécuriser leur engagement. Les pactes conclus avant 2016 ne sont pas épargnés : leur requalification en contrats à durée indéterminée appelle, dans certains cas, à une renégociation contractuelle.
Il est donc fortement conseillé, pour tous les pactes existants ou futurs, de procéder à un audit contractuel afin d’éviter toute insécurité juridique, qu’elle provienne d’une résiliation unilatérale imprévue ou d’un engagement qui perdurerait dans le silence contractuel. Les conséquences échéantes pouvant être lourdes et coûteuses.
Le cabinet Bruzzo-Dubucq se tient à vos côtés pour sécuriser vos pactes de préférence et vous accompagner dans la rédaction, la renégociation ou la résiliation de vos engagements contractuels.