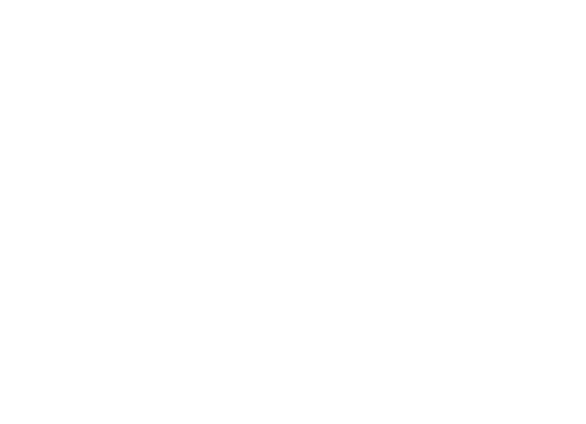Par la voie de l’autorité judiciaire, le droit social ne cesse de se réformer. Il pourrait s’agir d’un paradoxe, s’agissant d’une matière qui, avec le droit pénal, a probablement été la plus retouchée des 20 dernières années par le législateur.
Ce paradoxe n’est cependant qu’apparent. Si le législateur a souhaité adopter un certain nombre de réformes libérales, avec pour objectif de faire sauter des verrous bien connus de la matière, la Cour de cassation, dans une sorte de contrerévolution conservatrice, semble au contraire poursuivre une logique expansive et protectrice des intérêts des salariés.
L’on se souvient de la jurisprudence relative aux plateformes, notamment celle applicable à Take Eat Easy (Soc., 28 novembre 2018, n° 17-20.079) ou Uber (Soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316), qui reconnaît le statut de salarié à leurs travailleurs.
Cette dynamique récente du droit social pourrait presque briser l’idée reçue selon laquelle le droit français serait surprotecteur. Par certains aspects, et de façon surprenante, il est au contraire moins-disant que le droit européen. Les quatre arrêts du 13 septembre 2023 en sont l’illustration.
Dans cette série d’arrêts remarqués du 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation remet en cause les solutions rendues jusqu’alors en matière de droit des salariés aux congés payés. C’est ici le droit européen qui invite la chambre sociale à adopter une solution protectrice des droits du salarié.
Dans une première espèce, la question se posait de savoir si un salarié pouvait acquérir des congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail à la suite d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle.
Les salariés demandeurs invoquaient notamment, à l’appui de leurs prétentions, l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui prévoit que « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
Le droit français, à l’article L. 3141-3 du Code du travail, transpose à première vue cette exigence : « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ».
Il semble donc distinguer selon que le salarié a ou non subi un arrêt de travail sur la période concernée, en exigeant un travail effectif pour l’employeur.
Le droit européen, considéré dans la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et tel qu’interprété par la Cour de Justice (CJUE, 20 janvier 2009, aff. n° C-350/06) est plus flou.
Tout au plus affirme-t-il que « tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales » (art. 7 de la directive précitée).
Jusqu’alors, la Cour de cassation considérait qu’une telle situation était conforme au droit européen, dès lors que la directive 2003/88/CE ne permet pas, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285).
Plus récemment, cependant, la Cour de Justice a battu en brèche cette position, et jugé que « qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée » (CJUE, 6 novembre 2018, aff. n° C-569/16)
La chambre sociale de la Cour de cassation se conforme désormais à cette décision de la Cour de Justice. Elle subit en ce sens l’inaction du législateur français qui, rappelons-le, a vu son comportement sanctionné par la cour administrative d’appel de Versailles. La juridiction administrative a en effet condamné la France pour non-transposition de la directive de 2003 précitée, qui prévoit un régime plus favorable en matière de congés payés que le droit français (CAA Versailles, 17 juill. 2023, n° 22VE00442).
Souvenons-nous également qu’au lendemain de l’arrêt du 6 novembre 2018, la Cour de cassation, dans son rapport annuel 2018, avait mis en évidence la contrariété du droit français à la directive de 2003 (p. 98 du rapport) et rappelé que direction générale du travail, compétente sur cette question, avait été sollicitée et n’avait pas donné de réponse (p. 99 du rapport).
C’est dire qu’une telle prise de position était prévisible pour les employeurs, ce qui les prive d’invoquer le principe de confiance légitime heurté par cette décision au demeurant rétroactive comme toute norme prétorienne.
La décision est par ailleurs doublement intéressante.
Sur le plan théorique, en premier lieu, à propos des sources du droit du travail. Cette solution est l’illustration, d’abord, de la force contraignante de la Charte des droits fondamentaux, qui trouve sa source dans le Traité de Lisbonne du 1er décembre 2009.
Elle révèle, ensuite, que si une directive non-transposée ne peut en principe être dotée d’un effet direct entre particuliers – employeur et salariés dans les espèces que nous commentons – la Charte des droits fondamentaux peut cependant, en privant d’effet les dispositions du droit national incompatibles avec elle, aboutir à un résultat similaire, au profit de l’effectivité des droits des travailleurs européens.
Sur le plan pratique, en second lieu, il faut désormais considérer que les employés en situation de maladie ou d’accident ont le droit de bénéficier de congés payés pendant leur période d’absence, même si celle-ci n’est pas liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Cette solution pose cependant la question de savoir ce qu’il doit advenir en présence d’un arrêt maladie de longue durée, s’étendant sur plusieurs périodes d’acquisition des droits à congés payés.
Une telle acquisition est semble-t-il exclue par la Cour de Justice, qui a jugé que « au regard de la finalité même du droit au congé annuel payé, directement conféré par le droit de l’Union à chaque travailleur, un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, empêché par le droit national de prendre son congé annuel payé durant ladite période, ne saurait avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période » (CJUE, 22 novembre 2011, aff. n° C-214-10).
Dans cette affaire, la durée de quinze mois avait été jugée conforme à la finalité du droit (§43). Pour la Cour de cassation, « un délai supérieur, par exemple seize ou dix-huit mois, pourrait également répondre à ce critère » (Rapport annuel 2017, p. 175).
Le droit français pourrait donc limiter l’acquisition de congés payés dans une telle situation. Mince équilibre que le législateur devra trouver rapidement, au prix d’une insécurité juridique au détriment des employeurs.
Dans une autre espèce jugée le 13 septembre 2023, la chambre sociale apporte une précision relative au droit à congés payés du salarié en congé parental.
Selon l’accord-cadre européen révisé du 18 juin 2009 sur le congé parental (art. 5, § 2), figurant à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, les « droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus en l’état jusqu’à la fin du congé parental. Ces droits s’appliquent à l’issue du congé parental, tout comme les modifications apportées à la législation, aux conventions collectives et/ou à la pratique nationales ».
En ce domaine, le droit français, à l’époque des faits, n’était pas contraire au droit européen, mais plutôt incomplet. Tout au plus l’article L. 1225-55 du Code du travail disposait-il qu’« à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ».
C’est la raison pour laquelle, et toujours dans une optique d’interprétation du droit français conforme au droit européen, la Cour de cassation affirme désormais que « lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail ».
Cette solution est aujourd’hui contenue dans le nouvel article L. 1225-54 du Code du travail issu de la loi du 9 mars 2023 : « lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé ».
Enfin, dans une quatrième espèce jugée le 13 septembre 2023, la chambre sociale précise la prescription applicable au droit à congés payés.
Sur ce point encore, la Cour de cassation se conforme au droit européen et plus précisément à la jurisprudence de la Cour de Justice, qui a considéré que « la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile » (CJUE, 22 septembre 2022, aff. C-120/21).
La Cour de cassation juge de son côté qu’« il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement ».
Elle rappelle également que « lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris », en ajoutant : « dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ».
Dans cette affaire, une formatrice indépendante, à la suite de la cessation de sa relation contractuelle, avait réussi à faire requalifier son contrat en contrat de travail. Elle réclamait également le droit à une indemnité de congés payés pour la période où elle avait exercé son activité, de 2005 à 2018. Puisque l’employeur n’avait pas rempli ses obligations en matière de congés payés à l’égard de cette travailleuse, qu’il considérait comme non salariée, la prescription ne pouvait lui être opposée. Ainsi, la travailleuse est titulaire du droit de percevoir l’indemnité de congés payés pour l’intégralité de la durée de son emploi, soit quatorze années. Dans cette situation, seule une compensation financière est envisageable en raison de la rupture du contrat. En revanche, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu, le salarié doit pouvoir bénéficier de ses jours de congés payés.
Le droit à congés payés a donc marqué la fin de l’année 2023 et doit occuper une place importante dans la révision des pratiques des employeurs.