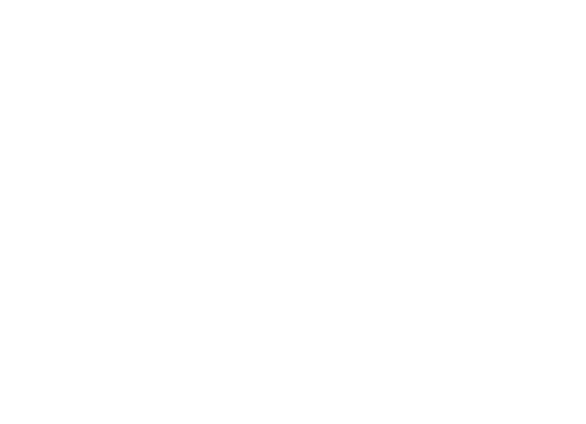La reconnaissance de dette incarne cette rencontre singulière entre la simplicité apparente d’un instrument juridique d’usage quotidien et la complexité théorique qui entoure sa véritable nature. Cet acte, par lequel une personne atteste devoir une somme d’argent ou une chose fongible à une autre, alimente depuis longtemps des controverses doctrinales quant à sa qualification juridique. La reconnaissance constitue-t-elle un acte créateur d’une obligation nouvelle ou se contente-t-elle de matérialiser une obligation préexistante ? Cette interrogation, loin de relever de la pure spéculation académique, détermine le régime juridique applicable et conditionne le sort contentieux de ces actes.
La doctrine contemporaine a progressivement convergé vers une analyse que la thèse de Madame Frering a magistralement synthétisée : la reconnaissance de dette possède une nature réalisatrice plutôt que constitutive (R. Frering, La reconnaissance de dette, thèse Lyon 3, 2022, n° 243, p. 251). Elle ne crée aucune obligation nouvelle mais se borne à matérialiser, à réaliser une obligation préexistante en lui conférant une existence probatoire tangible. Cette conception, qui implique l’application à la reconnaissance de dette du régime des contrats créateurs d’obligations, se heurte toutefois à des difficultés systémiques considérables et ne correspond pas à l’état actuel du droit positif. Au-delà de ces considérations théoriques dont nous ne ferons qu’esquisser les contours, l’enjeu pratique demeure central : comment sécuriser la reconnaissance de dette et quels effets produit-elle concrètement ?
L’objet du présent article consiste à mettre en lumière les conditions d’efficacité de la reconnaissance de dette et ses effets juridiques, dans une perspective résolument opérationnelle destinée à éclairer tant les praticiens que les particuliers amenés à recourir à cet instrument.
I. Les conditions d’efficacité de la reconnaissance de dette
La nature réalisatrice de la reconnaissance de dette commande d’envisager ses conditions d’efficacité sous un angle particulier, distinct de celui des actes créateurs d’obligations. Là où ces derniers sont soumis aux conditions de validité prévues par les articles 1128 et suivants du Code civil, la reconnaissance de dette appelle un examen centré sur la préexistence de la dette qu’elle matérialise, sur le respect des exigences probatoires qui conditionnent sa force, et sur l’intégrité du consentement de son auteur.
A. La préexistence de la dette et les exigences formelles
La préexistence de la dette constitue la condition objective cardinale de l’efficacité de la reconnaissance, tandis que les exigences formelles de l’article 1376 du Code civil en conditionnent la force probante.
La préexistence de la dette découle directement de la nature réalisatrice de la reconnaissance : un acte qui a pour fonction de matérialiser une obligation ne peut produire d’effet utile en l’absence de l’obligation qu’il prétend établir (R. Frering, préc., n° 278, p. 292). Sous l’empire du droit antérieur à la réforme de 2016, la jurisprudence contrôlait systématiquement cette préexistence sur le fondement des articles 1131 et 1132 du Code civil relatifs à la cause de l’obligation. La Cour de cassation considérait que la cause de la reconnaissance de dette était présumée exister et être licite de sorte qu’il appartenait au débiteur de démontrer l’absence ou l’illicéité de cette cause (Cass. 1ère civ., 7 avril 1992, n° 90-19.858, Bull. civ. I n° 114).
La suppression de la référence à la cause par l’ordonnance du 10 février 2016 a conduit à s’interroger sur la pérennité de cette solution. Une telle crainte se révèle néanmoins infondée dès lors que l’on comprend que l’ancien article 1132 ne constituait qu’une application du droit commun de la preuve (R. Libchaber, note sous Cass. 1ère civ., 21 juin 2005, Defrénois 2005, p. 1998). Lorsque l’on requiert la preuve par écrit d’un engagement, on ne s’arrête pas sur les conditions de validité telles que la capacité ou les vices du consentement (R. Frering, préc., n° 342, p. 361). De même, la reconnaissance de dette qui n’énonce pas la raison de l’engagement permet néanmoins d’établir l’existence de la dette, charge au débiteur de rapporter la preuve contraire.
Le contrôle de la préexistence s’opère désormais par le truchement des règles relatives à la charge de la preuve telles qu’elles résultent de l’article 1353 du Code civil. Lorsque le créancier présente une reconnaissance de dette, celle-ci lui permet de satisfaire la charge de la preuve de sa prétention, à savoir l’obtention du paiement de la dette (R. Frering, préc., n° 274, p. 289). L’absence de dette préexistante prive la reconnaissance de toute efficacité sans qu’il soit besoin de prononcer une quelconque sanction.
L’article 1376 du Code civil impose que la reconnaissance comporte la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Cette disposition poursuit une double finalité : elle contraint le débiteur à une prise de conscience effective de l’étendue de son engagement et prévient les falsifications éventuelles de l’acte. La jurisprudence a précisé que ces exigences s’analysent comme des formalités requises ad probationem et non ad validitatem (Cass. 1ère civ., 15 novembre 1989, n° 87-18.003, Bull. civ. I n° 348). Leur absence n’entraîne donc pas la nullité de la reconnaissance mais affecte sa force probante. L’acte qui ne satisfait pas à ces exigences ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, nécessitant d’être complété par d’autres éléments pour établir l’existence de la dette (Cass. 1ère civ., 3 avril 1973, n° 72-10.117, Bull. civ. I n° 126 ; Cass. 1ère civ., 4 juillet 2019, n° 18-10.139, inédit).
B. Les vices du consentement : comment déjouer la reconnaissance de dette ?
La reconnaissance de dette, bien qu’elle constitue un acte probatoire, n’échappe pas à l’application des vices du consentement prévus par le droit commun des contrats. La volonté de son auteur doit être à la fois libre et éclairée. Toutefois, l’application de ces vices présente des particularités tenant à sa nature réalisatrice et à sa fonction probatoire (R. Frering, préc., n° 296 et s., pp. 313 et s.).
La violence trouve naturellement à s’appliquer à la reconnaissance de dette. Il convient toutefois de souligner une particularité importante : à la différence des autres vices du consentement, la violence ne sanctionne pas nécessairement une erreur quant à la réalité de la dette. L’auteur pourrait avoir été contraint de signer une reconnaissance au bénéfice de son créancier alors même qu’il était bien débiteur. La Cour de cassation insiste pour que les juges du fond distinguent bien ces deux fondements, et a par exemple censuré l’arrêt qui avait débouté l’auteur d’une reconnaissance fondant une action en nullité sur le vice de violence aux motifs que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’absence de dette (Cass. 1ère civ., 30 juin 1998, n° 96-14.812, inédit).
Un arrêt récent du 13 mars 2024 illustre par ailleurs l’exigence jurisprudentielle quant à l’appréciation temporelle de la preuve du vice (Cass. 1ère civ., 13 mars 2024, n° 22-20.216). Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi soutenait que la preuve de l’existence du vice pouvait résulter d’éléments postérieurs à la date de formation du contrat. Il invoquait un courrier en date du 15 avril 2017 établissant une contrainte, alors que la reconnaissance avait été signée le 25 février 2017. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la lettre postérieure n’était pas révélatrice d’une contrainte exercée au moment de l’acte.
L’erreur et le dol trouvent également à s’appliquer, dès lors que l’objet de la reconnaissance consiste en l’établissement d’une dette. Les qualités essentielles de cet objet sont alors l’existence de la dette et son montant (R. Frering, préc., n° 302, p. 317).
Au-delà de leur application classique, l’erreur et le dol revêtent en matière de reconnaissance de dette une dimension stratégique particulière tenant aux règles de la preuve. Lorsque la reconnaissance constitue un acte sous signature privée satisfaisant aux exigences de l’article 1376 du Code civil et valant dès lors comme preuve littérale au sens de l’article 1359, ce dernier texte impose que la preuve contraire soit rapportée par écrit. Le défendeur doit par conséquent produire soit un écrit respectant les formes nécessaires, soit un commencement de preuve par écrit corroboré d’autres éléments de preuve. Or, la jurisprudence considère que les vices du consentement constituent des faits juridiques dont la preuve peut être rapportée par tous moyens (Cass. 1ère civ., 17 juin 2010, n° 09-14.854, inédit, cité par R. Frering, préc., n° 312, p. 327).
Invoquer l’absence de dette préexistante au moyen du dol ou de l’erreur peut dès lors permettre au défendeur de s’affranchir de la règle restrictive de l’article 1359 du Code civil (R. Frering, préc., n° 312, pp. 327-328). Le résultat demeure identique : le simple fait d’avoir démontré que la dette n’existait pas rend la reconnaissance inefficace. Mais le moyen pour y parvenir peut être bien moins contraignant puisque ce fondement laisse le défendeur libre dans l’administration de la preuve, alors même que la reconnaissance revêt la forme d’une preuve littérale dont la contestation exigerait ordinairement la production d’un écrit.
II. Les effets de la reconnaissance de dette
La reconnaissance de dette produit deux effets juridiques essentiels qui en font l’utilité pratique : un effet probatoire qui permet au créancier d’établir l’existence et l’étendue de sa créance, et un effet interruptif de prescription qui efface le délai déjà écoulé et fait courir un nouveau délai.
A. L’effet probatoire : la preuve de l’existence et de l’étendue de la dette
La reconnaissance de dette permet au créancier de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de sa créance, le dispensant ainsi de prouver l’acte juridique constitutif à l’origine de l’obligation. Cette fonction probatoire se trouve au cœur du mécanisme de la charge de la preuve.
La reconnaissance de dette régulière permet à son bénéficiaire de satisfaire la charge de la preuve relative à sa prétention, à savoir l’obtention du paiement de la dette (R. Frering, préc., n° 274, p. 289). Le prétendu débiteur qui conteste doit assumer la charge de la preuve de l’inexistence ou de l’extinction de la dette. La reconnaissance qui n’énonce pas la raison de l’engagement conserve néanmoins sa pleine efficacité probatoire, cette solution résultant d’une simple application du droit commun de la preuve (R. Libchaber, préc.). La remise de la reconnaissance de dette au débiteur fait présumer sa libération par application de l’article 1342-9 du Code civil.
La reconnaissance de dette intervenant dans le cadre d’un prêt d’argent soulève des questions probatoires spécifiques. La jurisprudence a consacré une distinction entre les prêts consentis par des particuliers, demeurant des contrats réels, et ceux consentis par des professionnels du crédit, devenus des contrats consensuels (Cass. 1ère civ., 28 mars 2000, Bull. civ. I n° 105).
S’agissant des prêts réels, la Cour de cassation considère que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds (Cass. 1ère civ., 19 juin 2008, n° 06-19.056 ; Cass. 1ère civ., 9 février 2012, n° 10-27.785, Bull. civ. I n° 26). Cette présomption dispense le prêteur qui produit une reconnaissance de rapporter toute autre preuve de la remise des fonds, charge au prétendu emprunteur de démontrer que cette remise n’a pas eu lieu (R. Frering, préc., n° 347, p. 365). La Cour de cassation a toutefois apporté un tempérament en présence d’une reconnaissance précisant que la remise se ferait à une date ultérieure, cas dans lequel le prêteur doit rapporter la preuve de la remise (Cass. 1ère civ., 9 février 2012, préc.).
S’agissant des prêts consensuels consentis par des établissements de crédit, la Cour de cassation a considéré que le créancier professionnel devait rapporter la preuve de la remise des fonds en plus de celle de l’existence du contrat de prêt (Cass. 1ère civ., 7 mars 2006, n° 02-20.734, Bull. civ. I n° 138). Cette distinction s’explique par la différence de nature de la remise des fonds : dans le prêt réel, elle constitue une condition de formation, tandis que dans le prêt consensuel, elle constitue l’exécution d’une obligation distincte (R. Frering, préc., n° 348 et s., pp. 366 et s.).
B. L’effet interruptif de prescription : l’anéantissement du délai écoulé
L’article 2240 du Code civil, reprenant la teneur de l’ancien article 2248, prévoit que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Cet effet interruptif constitue l’un des principaux effets pratiques de la reconnaissance de dette et anéantit le temps déjà écoulé, faisant courir un nouveau délai de prescription.
Une large partie de la doctrine explique l’interruption de la prescription au regard du fondement même de cette institution. La prescription repose sur l’idée d’une mise en conformité du droit avec une situation de fait prolongée. L’interruption de la prescription sous-entend une véritable rupture dans la situation de fait en voie de consolidation. La reconnaissance de dette met fin, pour un instant de raison, à la contradiction du fait et du droit sans laquelle la prescription ne peut s’accomplir. D’une part, elle fait cesser le litige en accordant les prétentions antagonistes. D’autre part, elle renouvelle juridiquement l’affirmation de l’existence du droit substantiel contredite par l’inaction du créancier (R. Frering, préc., n° 171, p. 177).
La reconnaissance de dette interrompt la prescription à l’égard de la totalité de la dette, peu importe que le montant reconnu ne corresponde pas à celui réellement dû. La Cour de cassation l’a affirmé très clairement, énonçant que « la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner » (Cass. 1ère civ., 22 mai 1991, n° 88-17.948, Bull. civ. I n° 164).
Il convient toutefois de souligner une limite essentielle : la reconnaissance de dette ne peut faire renaître un droit déjà prescrit. Si la prescription est acquise au moment où intervient la reconnaissance, celle-ci ne peut produire aucun effet interruptif (Cass. 1ère civ., 5 juin 2019, n° 18-20.914, inédit ; Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-17.957, inédit). Cette solution s’impose tant au regard de l’ordre public que de la cohérence du système juridique, la reconnaissance ne pouvant ressusciter un droit éteint.
L’article 2231 du Code civil, introduit par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, prévoit en effet que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ». Le temps jusque-là écoulé est anéanti et ne pourra pas être comptabilisé pour prescrire. Le compte à rebours doit reprendre du début et le délai nouveau nécessaire pour prescrire est de même durée que l’ancien. Cette solution, quoique consacrée par la loi portant réforme de la prescription, était acquise de longue date en jurisprudence.
Enfin, la réforme de 2008 a mis fin à une pratique jurisprudentielle controversée dite d’« interversion de prescription ». Antérieurement à cette réforme, certaines courtes prescriptions, notamment celles prévues par les anciens articles 2271 et suivants du Code civil, pouvaient être interrompues par une reconnaissance de dette, ce qui avait pour effet de substituer au délai court de prescription un délai de droit commun plus long. Cette interversion reposait sur une interprétation discutable de la novation et avait fait l’objet de vives critiques doctrinales. L’article 2231 du Code civil a condamné cette pratique en rappelant le principe selon lequel le nouveau délai qui court postérieurement à l’interruption demeure identique à l’ancien.
Conclusion
La reconnaissance de dette, loin de constituer un simple écrit dépourvu d’enjeux théoriques, s’impose comme un instrument juridique dont la compréhension commande d’articuler avec rigueur les considérations relatives à sa nature et celles tenant à son régime.
Pour le praticien comme pour le particulier, la sécurisation de la reconnaissance de dette suppose d’abord une compréhension claire de sa véritable nature. Au-delà du respect des formalités probatoires imposées par l’article 1376, il convient de veiller à ce que la reconnaissance corresponde effectivement à une dette préexistante dont la réalité pourra, le cas échéant, être démontrée. La mention de l’origine de la dette, bien que non strictement obligatoire, demeure hautement recommandable dans la mesure où elle permet de prévenir toute contestation ultérieure et facilite considérablement l’exercice de la charge de la preuve en cas de litige. L’intervention d’un conseil lors de la rédaction de l’acte constitue une précaution dont l’utilité se vérifie a posteriori lorsque survient le contentieux. La reconnaissance de dette demeure ainsi, dans sa simplicité apparente, un acte juridique dont la maîtrise technique conditionne l’efficacité pratique et dont la compréhension théorique éclaire les enjeux contentieux.