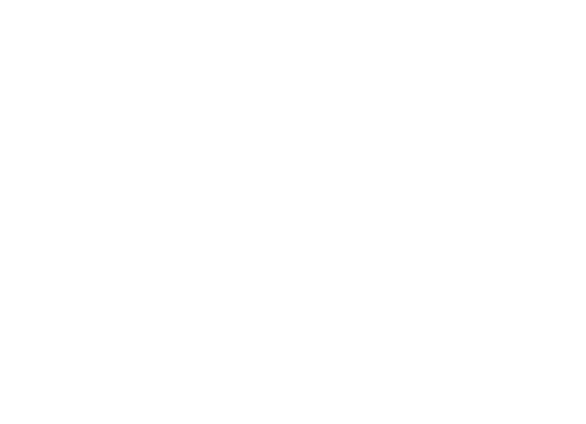Commentaire d’arrêt de Com., 17 septembre 2025, n° 24-10.604
L’exigence de précision de l’offre de contracter, principe fondamental de la théorie générale des contrats, trouve dans les cessions de parts sociales un terrain d’application particulièrement délicat. Lorsque l’engagement porte sur des titres sociaux dont l’existence même demeure incertaine au moment de la proposition contractuelle, jusqu’où peut s’étendre la notion d’objet « déterminable » au sens de l’article 1163 du Code civil sans compromettre les impératifs de sécurité juridique inhérents à toute transaction ? Cette interrogation fondamentale traverse la décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 septembre 2025.
Les faits de l’espèce illustrent parfaitement les enjeux contemporains des opérations de structuration financière. Le 17 octobre 2017, MM. P. et X. proposent à M. U. de lui céder 17,09 % du capital d’une société qu’ils avaient « l’intention de créer », à savoir la société à responsabilité limitée Credere, destinée à présider la société Carte financement et à en détenir une partie du capital. Cette offre anticipée, formulée moyennant le prix de 72 000 euros, précède donc la constitution effective de la société dont les parts font l’objet de la cession projetée. Après avoir vainement mis en demeure les pollicitants de procéder à la cession, M. U. les assigne, ainsi que les sociétés finalement constituées, afin de voir dire parfaite cette cession.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 16 mai 2023, avait retenu que la proposition était « claire et précise quant aux éléments de la cession », identifiant la chose cédée comme « 17,09 % des parts de Newco » et fixant le prix à 72 000 euros. Les juges du second degré avaient estimé, en outre, que « la circonstance que les titres ne soient pas davantage identifiés, en particulier par leur numérotation, ne rendait pas cette proposition équivoque », concluant dès lors à l’existence d’une offre valable au sens de l’article 1114 du Code civil. Cette analyse fait l’objet d’un pourvoi en cassation, les demandeurs soutenant qu’« en l’absence d’identification précise des parts sociales objet de la cession, tant dans leur nombre que par leur numérotation, la proposition ne saurait être qualifiée d’offre ferme et précise ».
La problématique juridique se cristallisait ainsi autour d’une question fondamentale : dans quelle mesure l’expression d’une offre de cession en pourcentage du capital social, en l’absence d’identification individualisée des parts sociales, satisfait-elle aux exigences de détermination posées par les articles 1114 et 1163 du Code civil ?
La Haute juridiction apporte à cette interrogation une réponse qui témoigne d’une conception résolument fonctionnelle de l’exigence de précision de l’offre. Après avoir rappelé la synthèse des conditions de validité de l’offre et de détermination de l’objet, elle affirme sans ambiguïté qu’« une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil ». Cette solution appelle une analyse en deux temps : elle procède d’abord de l’affirmation de la suffisance du pourcentage du capital social au regard des exigences de détermination de l’offre contractuelle (I), révélant ensuite la portée d’une solution qui fait émerger un régime adapté aux spécificités des cessions anticipées de parts sociales (II).
I. L’affirmation de la suffisance du pourcentage du capital social au regard des exigences de détermination de l’offre contractuelle
La démonstration opérée par la Cour de cassation procède d’une synthèse des dispositions gouvernant la formation contractuelle et la détermination de l’objet des obligations. Cette synthèse révèle une conception extensive de la notion de contenu « déterminable », qui privilégie l’approche fonctionnelle sur l’identification matérielle (A), tout en écartant l’objection tenant à l’absence de numérotation des titres (B).
A. La reconnaissance du caractère déterminable de l’objet exprimé proportionnellement
L’architecture argumentative de l’arrêt témoigne d’une certaine rigueur dans l’articulation des fondements textuels de la solution retenue. La Cour procède par étapes successives, rappelant d’abord que « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation » (article 1114 du Code civil), avant de préciser que « les éléments essentiels du contrat de vente sont la chose et le prix » (article 1583 du Code civil), pour conclure que « la prestation, objet de l’obligation, doit être déterminée ou déterminable » selon l’article 1163 du Code civil.
L’exigence de détermination ou de déterminabilité de l’objet constitue ainsi la clé de voûte du raisonnement, l’article 1163 disposant que « la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
Cette définition de l’objet déterminable revêt une importance capitale dans l’économie de la décision. Elle établit en effet que la déterminabilité ne suppose pas une identification matérielle exhaustive de la prestation, mais seulement que celle-ci puisse être « déduite » des éléments contractuels existants. Or, l’expression « 17,09 % des parts de Newco » répond manifestement à cette exigence, puisqu’elle permet d’identifier avec précision la quotité de capital social faisant l’objet de la cession, indépendamment de toute référence à la numérotation spécifique des titres concernés.
Cette interprétation extensive de la notion de déterminabilité s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui privilégie la substance économique de l’opération sur ses modalités techniques d’individualisation. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser qu’une « vente de parts sociales est conclue lorsque les parties sont d’accord sur le prix et sur le principe de son indexation même si elles ne sont pas encore tombées d’accord sur les modalités de sa mise en œuvre » (Cass. 3e civ., 16 juill. 1974, n° 73-11.275). Cette jurisprudence révélait déjà une conception fonctionnelle de la détermination contractuelle, qui trouve dans la présente décision une application particulièrement éclairante.
L’innovation de l’arrêt du 17 septembre 2025 réside toutefois dans la consécration explicite du pourcentage comme modalité autonome de détermination de l’objet. Là où les précédents jurisprudentiels concernaient principalement les modalités de fixation du prix ou les conditions d’exécution du contrat, la présente solution établit que le pourcentage du capital constitue, en lui-même, une détermination suffisante de la chose cédée. Cette évolution témoigne d’une adaptation du droit des contrats aux réalités des opérations financières contemporaines, où la référence proportionnelle constitue souvent l’unique modalité praticable d’identification des droits sociaux dans les phases préliminaires des projets d’investissement.
B. L’indifférence de l’absence de numérotation des titres au regard de la validité de l’offre
Le second volet de la démonstration jurisprudentielle procède d’une hiérarchisation entre les éléments substantiels et accessoires de la détermination contractuelle. La Cour relève que la cour d’appel a « énoncé à bon droit que la circonstance que les titres ne soient pas davantage identifiés, en particulier par leur numérotation, ne rendait pas cette proposition équivoque », validant ainsi une conception fonctionnelle de l’exigence de précision.
Cette position jurisprudentielle mérite d’être analysée au regard des critères traditionnels de validité de l’offre de contracter. Une jurisprudence constante pose qu’une « proposition de contracter ne constitue une offre que si elle implique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation » (Cass. com., 6 mars 1990, n° 88-12.477), cette intention devant se manifester par une précision suffisante des éléments essentiels du contrat projeté. Or, l’absence de numérotation des parts sociales pourrait a priori être perçue comme un défaut de précision susceptible de vicier la proposition contractuelle.
La Cour de cassation écarte résolument cette objection en établissant une distinction entre les éléments nécessaires à la détermination de l’objet et ceux qui relèvent des modalités techniques de son individualisation. Cette distinction revêt une portée théorique considérable, car elle consacre une approche téléologique de l’interprétation contractuelle qui privilégie la finalité économique de l’engagement sur ses modalités formelles d’exécution.
L’arrêt du 17 septembre 2025 apporte une précision en établissant explicitement que l’absence de numérotation ne constitue pas un obstacle à la qualification d’offre valable. Cette position témoigne d’une évolution significative de la conception jurisprudentielle de l’exigence de précision, qui s’adapte aux particularités des opérations sur titres sociaux où l’identification numérique des parts peut s’avérer impossible ou impraticable au stade de l’engagement initial.
L’analyse des motifs de l’arrêt révèle, en définitive, une conception renouvelée des rapports entre forme et substance en matière contractuelle. La Cour privilégie résolument l’efficacité économique de l’engagement sur ses modalités techniques d’individualisation, consacrant ainsi une philosophie contractuelle adaptée aux exigences de célérité et de souplesse qui caractérisent les transactions financières contemporaines.
II. La portée de la solution : l’émergence d’un régime adapté aux spécificités des cessions anticipées de parts sociales
La solution consacrée par l’arrêt du 17 septembre 2025 dépasse la simple résolution d’un cas d’espèce pour sécuriser les opérations de structuration financière contemporaines (A), tout en soulevant des interrogations sur les limites de cette libéralisation jurisprudentielle (B).
A. La sécurisation des opérations de structuration financière et des montages d’investissement
L’arrêt commenté répond à une nécessité économique pressante en légitimant juridiquement les pratiques contractuelles développées par les acteurs du corporate. La situation litigieuse, caractérisée par une offre de cession portant sur des parts d’une société « qu’ils avaient l’intention de créer », illustre parfaitement les contraintes temporelles inhérentes aux opérations d’investissement contemporaines, où l’engagement des investisseurs doit souvent précéder la constitution formelle des structures juridiques destinataires des fonds.
Cette chronologie particulière trouve son origine dans les exigences pratiques du capital-investissement et des opérations de structuration complexe, où la mobilisation des ressources financières nécessite des engagements fermes et irrévocables de la part de l’ensemble des parties prenantes. L’absence de fondement jurisprudentiel clair pour de tels engagements anticipés constituait jusqu’alors un facteur d’insécurité juridique susceptible d’entraver le développement de ces opérations ou d’en accroître considérablement les coûts de transaction.
En validant explicitement la suffisance de la détermination proportionnelle, la Cour de cassation élimine cette incertitude juridique et confère une assise solide aux pratiques contractuelles développées par les praticiens.
L’impact de cette jurisprudence dépasse, en outre, le seul domaine des cessions de parts sociales pour s’étendre à l’ensemble des opérations impliquant des engagements anticipés sur des actifs en cours de création. Les opérations de titrisation, les montages de défaisance, ou encore les restructurations complexes impliquant la création d’entités ad hoc pourront désormais s’appuyer sur ce précédent jurisprudentiel pour structurer des engagements fermes préalables à la constitution des véhicules juridiques concernés.
Cette extension potentielle de la solution témoigne de sa cohérence avec les principes fondamentaux du droit des contrats, qui privilégient l’effectivité de l’engagement contractuel sur ses modalités formelles de réalisation. L’arrêt du 17 septembre 2025 s’inscrit ainsi dans une logique d’adaptation permanente du droit jurisprudentiel aux évolutions économiques et financières, préservant la compétitivité et l’attractivité de l’environnement juridique français dans un contexte de concurrence internationale accrue entre les systèmes juridiques.
B. Les interrogations subsistantes
Si la solution consacrée par l’arrêt apporte une clarification bienvenue sur les conditions de validité des offres proportionnelles, elle laisse subsister plusieurs interrogations relatives aux modalités concrètes d’application de ce principe et aux limites de son champ d’intervention.
Si la solution consacrée par l’arrêt apporte une clarification bienvenue sur les conditions de validité des offres proportionnelles, elle appelle une observation relative à son champ d’application et aux modalités concrètes de son déploiement. Celle-ci porte sur les modalités concrètes d’exécution des cessions ainsi validées dans l’hypothèse particulière où la société concernée aurait émis des titres assortis de droits différents. Si l’arrêt établit que l’absence de numérotation ne fait pas obstacle à la validité de l’offre lorsque les titres sont fongibles entre eux, la question se complexifie lorsque coexistent plusieurs catégories de parts sociales ou d’actions conférant des droits distincts (actions de préférence, parts à dividende prioritaire, titres à droit de vote multiple). Dans ce cas spécifique, la détermination proportionnelle pourrait s’avérer insuffisante pour identifier précisément la nature des droits effectivement transférés, nécessitant des précisions complémentaires que l’arrêt n’évoque pas.
À retenir
La décision commentée valide définitivement la pratique des offres de cession exprimées en pourcentage du capital social, même en l’absence de constitution préalable de la société émettrice.
L’absence de numérotation ou d’identification précise des parts sociales ne constitue plus un obstacle à la validité de l’offre contractuelle, dès lors que la quotité cédée est clairement exprimée en pourcentage du capital. Cette solution simplifie considérablement la rédaction des actes préparatoires et des protocoles d’investissement.
Pour qu’une offre de cession proportionnelle soit valable, il suffit que soient déterminés le pourcentage du capital social concerné, l’identité de la société (fut-elle en cours de constitution), et le prix de la cession.
Malgré cette souplesse jurisprudentielle, les praticiens conserveront intérêt à préciser les modalités d’exécution de la cession (désignation des titres, formalités de transfert, conditions de réalisation) pour éviter les difficultés ultérieures d’exécution contractuelle, ces éléments n’étant pas couverts par la décision commentée.