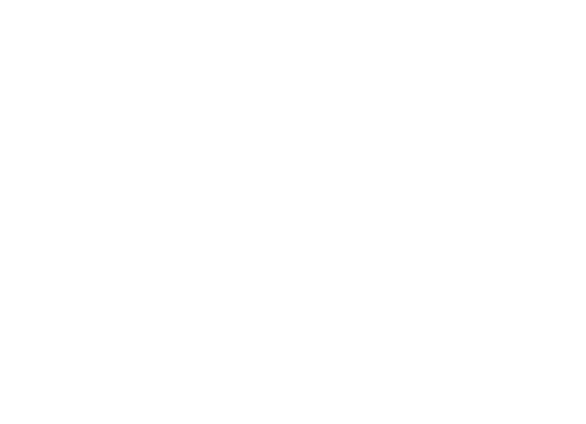Création purement prétorienne née de la nécessité de tirer les conséquences de la qualification de revenus réputés distribués par l’article 109 du CGI, la notion de « maître de l’affaire » permet d’identifier le contribuable exerçant des pouvoirs suffisant à considérer qu’il est celui qui a appréhendé lesdits revenus.
Cependant, l’influence d’une telle qualification et par extension le rôle de l’avocat fiscaliste varient en cas de contrôle, au gré des fondements employés par l’administration pour opérer ses redressements.
I. Le « maître de l’affaire » : développement et influence de la notion
Développée par la jurisprudence, la notion de maître de l’affaire est conditionnée à un faisceau d’indices afin d’en retenir la qualification.
1. Le développement de la notion de maître de l’affaire
S’il n’existe pas de définition légale de la notion, la jurisprudence[1] est venue qualifier de maître de l’affaire la personne « qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale, et financière de la société et qui dispose sans contrôle des fonds. »
L’application d’une telle qualification se fonde sur le critère du pouvoir exclusif sur la gestion de l’entreprise qui implique de rechercher si une personne dispose des biens de la société comme s’il s’agissait de ses biens propres.
Il en résulte que ne peut exister qu’un seul et unique maître de l’affaire[2] sauf époux soumis à une imposition commune[3].
Concrètement, pour parvenir à établir la qualité de maître de l’affaire, l’administration doit se fonder sur un faisceau d’indices permettant d’examiner les conditions effectives de gestion de l’entreprise contrôlée : détention capitalistique significative, gérance de droit ou de fait, disposition de la signature sociale, représentation de la société et rapports avec les tiers etc.
2. L’influence de la notion de maître de l’affaire
L’effet principal de la qualité de maître de l’affaire est qu’elle fait peser sur le contribuable une présomption irréfragable d’appréhension effective des revenus distribués. Lorsqu’une telle qualité est établie à l’égard d’un contribuable, celui-ci doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 109 du CGI.
Autrement dit, une fois le contribuable qualifié de maître de l’affaire, il ne peut plus combattre la présomption et toute preuve du fait qu’il n’a pas effectivement appréhendé les sommes en cause sera privée d’effet.
En pratique, en présence d’une société pluripersonnelle, la jurisprudence se montre plutôt favorable à l’égard du contribuable en admettant un élargissement du faisceau d’indices du moment que ce dernier parvient à rapporter la preuve du fait qu’il ne peut être démontré qu’il y a un seul et unique maître de l’affaire.
En revanche, en présence d’une société unipersonnelle, selon le fondement sur lequel se base l’administration, la notion de maître de l’affaire va venir servir ses intérêts puisque la présomption d’appréhension des sommes en cas d’identification d’un seul et unique maître de l’affaire va alors venir limiter la marge de manœuvre à la disposition de l’avocat dans le cadre de la défense du contribuable.
II. Le « maître de l’affaire » : ambivalence des fondements employés par l’administration
1. L’article 109, 1°1 : présomption et bases légales
L’alinéa premier du 1 de l’article 109 du CGI dispose que sont considérés comme revenus distribués :
« 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
(…) »
Il en résulte une présomption légale de distribution à l’égard de tous les bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise quelle que soit la forme de la distribution.
L’administration doit alors rapporter la preuve que les bénéfices n’ont pas été réinvestis dans l’entreprise, on parle de « désinvestissement du patrimoine social ».
Deux conditions se dégagent donc du texte pour imposer les sommes entre les mains du contribuable :
- le désinvestissement du patrimoine social (en application d’une présomption de distribution) ;
- l’appréhension effective des sommes par le bénéficiaire (en application d’une présomption d’appréhension si le contribuable est reconnu maître de l’affaire).
Dans le cadre de l’application de ce premier alinéa, l’influence de la notion de maître de l’affaire est alors très importante et ne se voit en pratique atténuée qu’en présence d’une société pluripersonnelle qui offre plus de latitude pour démontrer qu’une pluralité de maîtres de l’affaire peut être caractérisée.
Or, si ce fondement permet de rendre plus probable le recouvrement des sommes réputées distribuées notamment par le biais du jeu des présomptions, le fait de ne pas s’appuyer sur l’alinéa 2° de l’article 109, 1 du CGI ne permet pas de réputer distribuées les sommes pour leur montant TTC.
Il résulte en effet d’une jurisprudence récente du Conseil d’État, que le montant regardé comme distribué par le jeu des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du CGI se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées[4].
Ainsi, si le 1° du 1 de l’article 109 du CGI permet à l’administration d’avoir plus de « chances » de voir ses redressements justifiés, notamment du fait d’un poids plus important de la notion de maître de l’affaire avec la présomption d’appréhension des sommes, le quantum des sommes réputées distribuées s’avèrera moins important que celui pouvant être obtenu sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du CGI (montant s’entendant HT et non pas TTC).
2. L’article 109,1°2 : preuve et enjeux
L’alinéa second du 1 de l’article 109 du CGI dispose que sont considérés comme revenus distribués :
« 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. »
Il en résulte une présomption légale de distribution à l’égard de tous les bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise quelle que soit la forme de la distribution.
Ici, n’est pas regardé le désinvestissement social du patrimoine de la société mais l’appréhension par le bénéficiaire déjà identifié (associé de la société) des sommes réputées distribuées.
L’administration doit alors rapporter la preuve que le contribuable a effectivement appréhendé les sommes, quand bien elle aurait prouvé par ailleurs que celui-ci était le seul maître de l’affaire.
Dans le cadre de l’application de ce second alinéa, l’influence de la notion de maître de l’affaire est alors réduite puisque la preuve de l’appréhension de revenus réputés distribués sur le fondement du 2° ne saurait résulter du seul fait que le contribuable a été reconnu bénéficiaire d’une distribution sur le fondement de l’article 109, 1, 1° du CGI.
En d’autres termes, l’administration ne rapportant pas la preuve d’une appréhension des sommes entre les mains du contribuable, elle ne peut alléguer du fait qu’une partie des sommes considérées comme distribuées sur le fondement de l’article 109, 1, 1° du CGI pouvait servir à redresser le contribuable à hauteur du montant des rappels dont l’appréhension n’est pas démontrée sur le fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI.
En pratique, se pose alors la question de savoir s’il existe un risque que l’administration développe une tendance à se fonder systématiquement sur l’alinéa premier notamment en présence d’une société unipersonnelle.
Quoiqu’il en soit, un tel risque est jugulé par le fait que les sommes reconstituées sur le fondement de l’alinéa premier ne pourraient alors être regardées que comme hors taxe.
III. Le « maître de l’affaire » : articulation des moyens de défenses à la disposition du contribuable
Tout comme l’administration ne saurait faire jouer de la même manière la notion de « maître de l’affaire » selon la base légale sur laquelle elle choisit de fonder ses redressements, l’axe de défense et la « méthodologie » de l’avocat fiscaliste diffèrent selon que l’administration fiscale fonde ses redressements sur l’article 109, 1, 1° du CGI ou sur l’article 109, 1, 2° du CGI.
1. La défense du contribuable redressé sur le fondement de l’alinéa premier : contestation de la qualité de maître de l’affaire et vérification des montants
Le premier axe de défense concerne la présomption légale d’appréhension puisqu’en cas de redressement fondé sur cette base, il reviendra à l’avocat de tenter de rapporter la preuve que d’autres personnes jouaient un rôle décisif dans la société (dans une plus grande mesure que dans le cas de rehaussements fondés sur l’alinéa 2).
Pour cela, une analyse du fonctionnement de l’entreprise devra être menée en présence d’un faisceau d’indices élargi par le flux de la jurisprudence : de la détention majoritaire du capital au pouvoir exclusif sur la gestion de l’entreprise en passant par la disposition sans contrôle des fonds sociaux ou encore l’absence d’implication des autres porteurs de parts dans la gestion de l’affaire.
Le second axe de défense concerne la présomption légale de distribution qui ne saurait en effet jouer selon la typologie du redressement.
Il a par exemple été jugé[5] qu’une erreur dans la passation des écritures comptables (inscription en charge de l’acquisition d’un actif qui aurait dû être immobilisé) n’a pas donné lieu à une sortie du patrimoine de la société de sorte que ne peut être mise en œuvre la présomption légale de distribution.
De même, la minoration de la valeur du stock de la société ne peut s’analyser en une appréhension de ce stock ou des revenus issus de sa vente[6].
Le troisième axe de défense vise à s’assurer que les sommes réputées distribuées sur le fondement de l’alinéa premier soient entendues HT et non pas TTC, en application des jurisprudences récentes du Conseil d’État.
2. La défense du contribuable redressé sur le fondement de l’alinéa second : contestation de l’appréhension effective et analyse factuelle
Contrairement à l’alinéa premier, le second alinéa ne permet pas de faire jouer une présomption légale d’appréhension.
La défense vise alors à contester l’appréhension effective notamment en démontrant l’absence d’un flux financier de la société vers le contribuable redressé.
Pour cela, l’avocat fiscaliste doit mener une analyse factuelle pouvant par exemple résulter en une analyse des relevés bancaires aboutissant à démontrer que le contribuable n’a jamais perçu de sommes d’un montant équivalent aux bénéfices rectifiés au niveau de la société.
***
Ainsi, si la notion de maître de l’affaire permet une mise œuvre très concrète des dispositions de l’article 109, 1, le poids d’une telle qualification dans la mise en œuvre de la procédure de rectification va fortement varier selon le fondement textuel invoqué par l’administration.
En effet, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’administration établit qu’un contribuable est maître de l’affaire elle peut mettre en œuvre à l’encontre de ce dernier la présomption d’appréhension des bénéfices rehaussés du côté de la société. Cependant, si le jeu des présomptions facilite la collecte de la preuve, les sommes susceptibles d’être rectifiées seront plus faibles car entendues hors taxe.
En revanche, pour l’application du second alinéa, le fait que le contribuable redressé soit maître de l’affaire importe peu dans la mesure où l’administration doit établir la réalité du flux financier des fonds sociaux vers le patrimoine de l’associé.
Le rôle de l’avocat fiscaliste subit ainsi l’influence du choix de l’administration à raison du fondement qu’elle emploie.
Dans le premier cas il lui reviendra de s’opposer à la qualification de maître de l’affaire en rapportant la preuve que d’autres personnes jouent un rôle décisif dans la société tout en s’assurant que les sommes sont hors taxe.
Dans le second cas il devra contester l’appréhension par le contribuable des sommes rectifiées.
[1] Conseil d’État, 14 septembre 2016, n°400882
[2] Conseil d’État, 22 février 2017, n°388887
[3] Conseil d’État, 16 mars 2019, n°433098
[4] Conseil d’État, 19 juillet 2024, n°491690
[5] Conseil d’État, 5 décembre 1984, n°46962
[6] Conseil d’État, 29 septembre 1989, n°75304