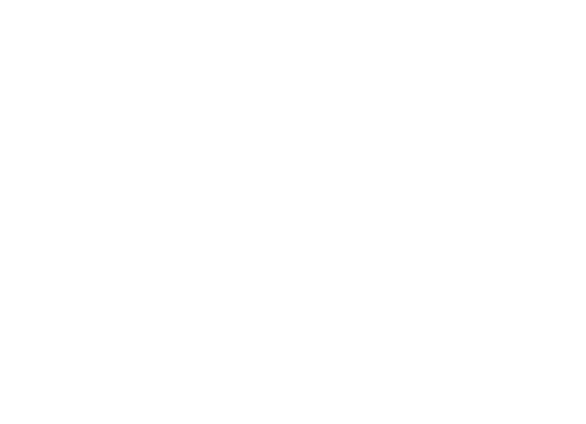Le récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 février 2025 dans l’affaire Athenian Brewery et Heineken (C-393/23) constitue une contribution significative à la jurisprudence relative à la compétence internationale en matière de pratiques anticoncurrentielles. Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorisant l’effectivité du droit de la concurrence au détriment, peut-être, de la prévisibilité des règles de compétence internationale.
I. Du droit matériel au droit processuel : la présomption d’influence comme fondement de la connexité
L’apport principal de cet arrêt réside dans l’extension du champ d’application de la présomption d’influence déterminante de la société mère au domaine du conflit de juridictions. Cette présomption, initialement développée en droit matériel de la concurrence, se trouve désormais mobilisée pour établir l’existence d’un « rapport si étroit » au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis.
A. La transposition d’une présomption matérielle au domaine procédural
La Cour de justice adopte une position innovante en permettant au juge de se fonder sur la présomption d’influence déterminante pour établir sa compétence internationale à l’égard de la filiale étrangère. Cette présomption, issue de la jurisprudence Akzo, permet traditionnellement d’imputer à une société mère la responsabilité d’une infraction commise par sa filiale lorsque la première détient la totalité ou quasi-totalité du capital de la seconde.
Dans son raisonnement, la Cour met en avant la notion d’« entreprise » en droit de la concurrence, notion autonome qui transcende la personnalité juridique distincte des entités qui la composent. Elle rappelle que cette notion « ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’imposition, par la Commission, d’amendes […] et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union » (point 40). C’est donc logiquement que cette même notion peut être mobilisée dans le cadre de l’appréciation de la compétence internationale.
Pour les praticiens du contentieux économique, cette solution offre un outil précieux permettant d’attraire devant un même juge la société mère et sa filiale, facilitant ainsi l’exercice des actions en réparation. Cette approche présente l’avantage de simplifier considérablement la procédure, en évitant la multiplication des instances dans différents États membres.
B. Une présomption encadrée au service de l’effectivité du droit de la concurrence
Si la Cour admet le recours à la présomption d’influence déterminante pour établir la compétence internationale, elle prend soin d’encadrer cette faculté. Le juge saisi doit se limiter à vérifier « qu’il n’est pas exclu a priori qu’une influence déterminante de la société mère à l’égard de la filiale ait existé » (point 45). Cette formulation prudente reflète la nécessité de ne pas préjuger du fond de l’affaire au stade de l’appréciation de la compétence.
Par ailleurs, la Cour précise que « la vérification de l’absence de caractère artificiel de la demande dirigée contre la société mère […] suppose que les parties défenderesses soient en mesure de se prévaloir d’indices probants suggérant soit que la société mère ne détenait pas directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, soit que cette présomption devrait néanmoins être renversée » (point 46).
Cette exigence semble toutefois principalement théorique. En pratique, cette présomption transposée au conflit de juridictions ne sera renversée que dans des situations exceptionnellement rares. L’impossibilité de procéder à un « examen détaillé des preuves » au stade de la compétence rend, en effet, particulièrement difficile le renversement de cette présomption.
II. Les implications pratiques pour le contentieux économique : entre forum shopping et sécurité juridique
L’arrêt commenté s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorisant le développement des actions privées en matière de pratiques anticoncurrentielles (private enforcement). Cette orientation de la Cour de justice n’est pas sans conséquence sur la prévisibilité des règles de compétence internationale.
A. Une facilitation stratégique du private enforcement
La solution retenue par la Cour de justice facilite indéniablement l’exercice des actions en réparation des dommages concurrentiels. Elle permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles de concentrer leur action devant un seul tribunal, celui du domicile de la société mère, plutôt que de devoir poursuivre la filiale devant les juridictions de son propre État membre.
Cette approche s’inscrit dans une stratégie jurisprudentielle plus large visant à encourager le private enforcement, comme en témoigne l’arrêt Courage de 2001. La Cour y avait affirmé que « les actions en dommages-intérêts devant les juridictions nationales sont susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans l’Union ».
Pour le praticien, cette jurisprudence ouvre des perspectives stratégiques intéressantes. Elle permet notamment d’attirer le contentieux vers des juridictions réputées pour leur expertise en matière de droit de la concurrence ou offrant des avantages procéduraux particuliers. L’on connait en effet l’attractivité des juridictions néerlandaises, allemandes et anglaises, en raison notamment des avantages tenant au droit substantiel applicable et de certains avantages procéduraux, tel que le financement de procès par un tiers particulièrement développé aux Pays-Bas.
B. Les risques d’une internationalisation artificielle du litige
L’approche adoptée par la Cour de justice n’est pas sans susciter certaines réserves. Elle peut en effet conduire à une internationalisation provoquée du litige. Dans l’affaire commentée, le litige présentait initialement un caractère purement interne, tant l’auteur que la victime des pratiques anticoncurrentielles étant établis en Grèce pour des pratiques commises sur le marché grec.
Cette internationalisation artificielle du litige peut être perçue comme un détournement de la règle de compétence de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis. La Cour affirme certes que cette disposition « ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle puisse permettre à un requérant de former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié » (point 23), mais sa mise en œuvre concrète de ce principe semble peu exigeante.
Cette tendance s’inscrit dans une évolution plus générale du droit international privé de l’Union européenne, où l’on observe une instrumentalisation croissante des règles de conflit au service d’objectifs matériels.
Pour le praticien du contentieux économique, cette évolution offre des opportunités stratégiques indéniables, mais elle introduit également une part d’incertitude dans la détermination de la juridiction compétente. Elle invite à une analyse fine des structures de groupe et des liens capitalistiques entre sociétés pour anticiper les risques de forum shopping.
En définitive, l’arrêt Athenian Brewery et Heineken illustre parfaitement la tension entre deux objectifs fondamentaux du droit international privé : la prévisibilité des solutions et l’effectivité des droits substantiels. En privilégiant cette dernière, la Cour de justice ouvre aux praticiens de nouvelles perspectives stratégiques, mais au prix d’une certaine dénaturation des règles traditionnelles de compétence internationale. Cette approche téléologique du droit international privé, si elle peut se justifier par la spécificité du droit de la concurrence, ne manquera pas de susciter des interrogations quant à sa possible extension à d’autres domaines du contentieux économique.